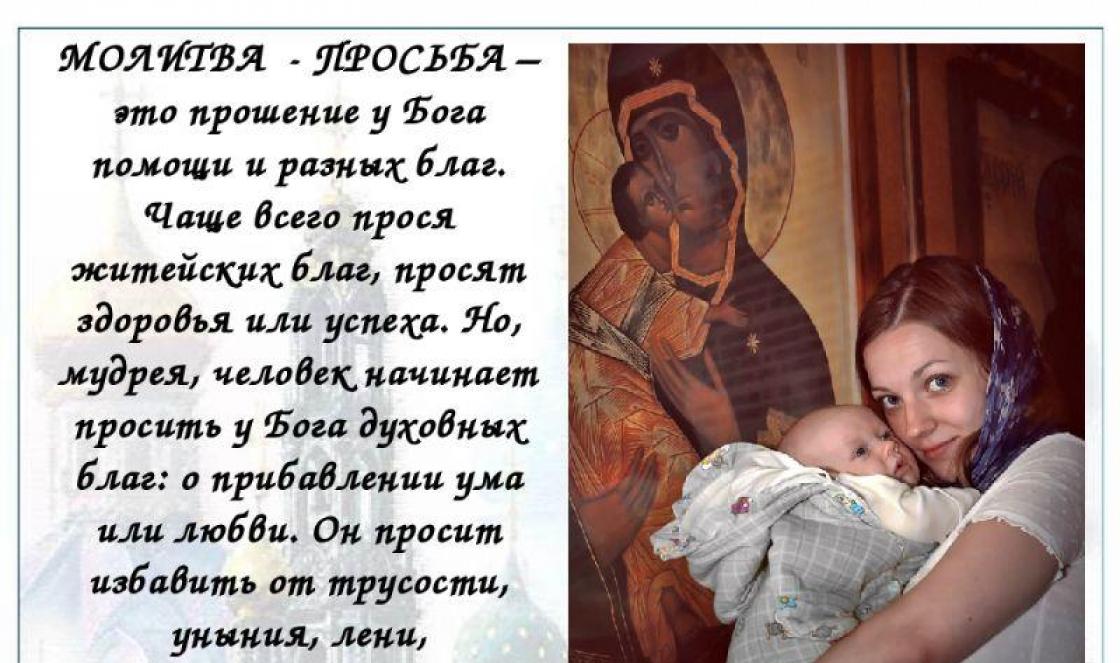Au Moyen Âge, les hérésies étaient principalement distribuées parmi le peuple. Les porteurs d'idées hérétiques, en règle générale, étaient des prédicateurs itinérants qui n'appartenaient à aucun des domaines. Souvent, ce sont les soi-disant. Les « vagabonds » sont des moines en fuite, des ecclésiastiques défroqués, des étudiants et des acteurs. Leur prédication était toujours anti-église et, en règle générale, anti-étatique. Les hérétiques du Moyen Âge niaient les sacrements et les rituels, ne reconnaissaient pas l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique et ridiculisaient le clergé. Souvent, tout pouvoir, y compris le pouvoir séculier, était nié en général, et une société basée sur la fraternité universelle et la communauté de propriété était proclamée comme un idéal. Des idées hérétiques ont parfois été introduites par des pèlerins ou des marchands revenant d'Orient, qui ont entendu de nombreux enseignements et mythes. différents peuples et sont souvent devenus des adeptes de croyances bizarres et éclectiques. Des sectes médiévales se formaient parfois autour de théologiens peu orthodoxes, qui étaient assez nombreux, car la soif de connaissances théologiques était grande et les querelles savantes se tenaient constamment dans toute l'Europe. Cependant, cela arrivait rarement. De tels groupes étaient formés exclusivement d'étudiants qui erraient d'un enseignant à l'autre, ces sectes étaient donc très instables et se désintégraient rapidement.
Du point de vue de la doctrine, les hérésies médiévales ne représentaient nullement un tout. Parmi eux se trouvaient des enseignements basés sur le gnosticisme renaissant ( Bogomiles, Albigeois ou cathares). D'autres, n'ayant pas un système théologique développé, ont construit leur doctrine uniquement sur la critique de l'Église, essayant d'imiter les idéaux des temps apostoliques inventés par eux-mêmes ( Vaudois). Au Moyen Âge, les héritiers de diverses hérésies anciennes qui ont tourmenté l'Église dans les premiers siècles du christianisme et n'ont pas été complètement détruits ont également été préservés (par exemple, divers groupes antitrinitaires). Un certain nombre de sectes ont surgi à la suite de la montée de la conscience nationale. Leurs fidèles s'opposent au catholicisme précisément en tant que foi universelle, rêvant de créer des communautés chrétiennes nationales indépendantes. Ceux-ci sont Frères tchèques ou frères polonais. Ces communautés sont devenues les précurseurs des églises protestantes ultérieures.
Les régions les plus propices à la propagation des hérésies au Moyen Âge étaient l'Europe de l'Est et le sud de la France. Ici, le christianisme était moins enraciné et les traditions païennes avaient une plus grande influence sur la population. Parfois, les enseignements hérétiques se sont répandus sur un vaste territoire et ont eu un impact notable sur la vie politique de l'Europe. Ainsi en fut-il, par exemple, des Albigeois, qui devinrent la cause d'un conflit armé à l'échelle paneuropéenne.
introduction
caractéristiques générales pensée politique du Moyen Âge européen
L'idée de domination théocratique dans les enseignements d'Augustin
Papauté et Empire
Hérésies médiévales
doctrine politique Thomas d'Aquin
Les vues du philosophe anglais W. Ockham
Conclusion
introduction
Le Moyen Âge est la période historique entre le monde antique et les temps modernes. Le terme « Moyen Âge » lui-même a été utilisé pour la première fois par les humanistes italiens au XVe siècle. pour caractériser ces siècles qui ont divisé leur temps et les temps de l'antiquité païenne. Selon la tradition, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident est considéré comme le début de l'ère médiévale, son achèvement - le XIVe siècle. Epoque du XVème siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, qui reçut le nom de Renaissance et de Réforme, est attribuée soit à la fin du Moyen Âge, soit au début du Nouvel Âge.
Les frontières du Moyen Âge peuvent être définies par différentes approches de l'histoire de la culture et de la politique. Cependant, dans tous les cas, il est nécessaire d'analyser le christianisme, puisque son idéologie est la base théorique du Moyen Âge.
Le principe fondamental de la pensée politique médiévale est la théocratie, c'est-à-dire la prédominance de l'idée du Divin et de l'idée de l'Église sur l'individu et l'État. L'idée théocratique a été développée en relation avec la formation et le renforcement de l'organisation de l'église. Il a pris forme au XIIIe siècle.
Caractéristiques générales de la pensée politique du Moyen Âge européen
Le christianisme est né au 1er siècle. dans les provinces orientales de l'Empire romain en tant que religion des opprimés, qui cherchaient à être délivrés des conditions de vie inhumaines lors de la venue du Messie (Sauveur). La plupart des communautés chrétiennes étaient pauvres. Aux I-II siècles. leur base sociale était constituée d'esclaves, d'affranchis, d'artisans, les femmes occupaient une place non négligeable parmi les premiers chrétiens.
Cependant, à partir de la fin du 1er - début du 2ème siècle. l'afflux de personnes des classes moyennes et même supérieures de la société vers les chrétiens a progressivement augmenté. La diffusion du christianisme dans différents groupes de la population a été facilitée par la nature de cet enseignement religieux, ainsi que par la forme d'organisation des chrétiens.
Les chrétiens se réunissaient à la fois dans des maisons privées appartenant à leurs coreligionnaires et en plein air. Quiconque voulait accepter la foi des chrétiens pouvait venir à eux. Lors de réunions appelées ekklesia (le mot "ekklesia" dans les villes grecques signifiait "assemblée du peuple" - autrefois l'organe principal de l'autonomie gouvernementale de la polis), les chrétiens écoutaient des sermons, des prophéties et lisaient des messages.
Chaque communauté avait ses propres prophètes, il y avait aussi des prophètes errants, qui, comme les apôtres (l'apôtre - "messager", "ambassadeur"), passaient de communauté en communauté. Les chrétiens appelaient les apôtres « messagers de Dieu », et eux-mêmes, frères et sœurs, ne connaissaient aucune hiérarchie des postes de la communauté. Mais il y avait de moins en moins de prédicateurs qui pouvaient se référer au fait qu'eux-mêmes écoutaient les disciples de Jésus, les annales ont commencé à remplacer la tradition orale textes sacrés.
Au 1er siècle dans certaines communautés pour obtenir des conseils vie courante les premiers anciens-presbytres sont apparus, ils ont été choisis par la communauté pour exercer des fonctions organisationnelles et économiques. Parfois, ils étaient appelés évêques, c'est-à-dire surveillants. Il y avait aussi des ministres du rang le plus bas - des diacres, parmi lesquels se trouvaient des femmes.
Aux II-III siècles. un nombre croissant de gens riches acceptèrent la nouvelle doctrine. Pour devenir de vrais chrétiens, ils devaient faire de la charité, donner une partie de leur richesse aux pauvres. Les riches étaient pour la plupart instruits, familiarisés avec la philosophie grecque.
Des ouvrages théoriques ont également été créés, justifiant les avantages du dogme chrétien. Parmi les premiers théologiens chrétiens figuraient le célèbre avocat Minucius Felix, le philosophe Clément d'Alexandrie, Origène.
La propagation du christianisme dans différents environnements ethniques a conduit à des différences de doctrine. Le processus de transformation du christianisme en une religion mondiale s'est déroulé dans une atmosphère de lutte entre les communautés. Le besoin d'unité et en même temps de diffusion du christianisme a conduit à comprendre les communautés de croyants non pas comme des communautés spécifiques entre lesquelles il peut y avoir des désaccords et même des inimitiés, mais comme une telle association de chrétiens qui possède la grâce de Dieu comme un ensemble - une église mystiquement liée au Divin.
Cependant, aux II-III siècles. il n'y a plus d'autonomie communale, mais une organisation ecclésiastique commence à prendre forme. Les évêques deviennent les seuls chefs des communautés : ils organisent le culte, sélectionnent les livres sacrés, jugent et pardonnent les chrétiens qui ont commis des délits, gèrent les biens. Les principaux évêques ont commencé à être appelés métropolitains (un métropolite est une personne de la ville principale).
Parallèlement à la complication de la hiérarchie des serviteurs supérieurs, le nombre de grades inférieurs a également augmenté. L'église s'est transformée en une organisation hiérarchique à plusieurs niveaux dans laquelle les rangs inférieurs dépendaient des rangs supérieurs. L'expression extérieure des changements qui ont eu lieu dans les communautés chrétiennes a été la construction de bâtiments spéciaux pour le culte - temples ou églises.
Pour les autorités romaines, les chrétiens étaient l'un des nombreux groupes religieux. La persécution officielle contre les chrétiens a commencé au milieu du IIIe siècle. Ainsi, l'empereur Dioclétien en 303 a publié un décret interdisant le culte chrétien dans tout l'empire. Les bâtiments de l'église ont été démolis, les biens confisqués, les livres brûlés.
Mais à ce moment-là, l'église était déjà suffisamment organisée, de nombreux livres ont été sauvés et une assistance a été fournie aux victimes. L'initiateur de la persécution des chrétiens, Galère, devenu empereur après l'abdication du pouvoir de Dioclétien, a annulé ces persécutions.
Au cours de cette première période de développement église chrétienne et la persécution des chrétiens a formé la première doctrine chrétienne. Les principales idées chrétiennes qui ont eu une grande influence sur le développement de la pensée politique sont les suivantes :
- l'idée de l'estime de soi de la personne humaine. Chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc chaque personne a une valeur infinie. Par amour pour l'homme et pour son salut du péché, Dieu lui-même a accepté la crucifixion. Un chrétien ne peut pas renoncer à sa personnalité, qui est basée sur l'image et la ressemblance de Dieu ;
- l'idée d'individualisme. Chaque personne a une âme immortelle avec le libre arbitre, pour ses actes, il est personnellement responsable devant Dieu;
- idée de l'égalité de tous devant Dieu. Le christianisme interprète l'idée d'égalité devant Dieu dans le sens que tous les chrétiens sont enfants du même Père. Le critique du christianisme F. Engels a interprété l'idée chrétienne d'égalité d'une manière différente, mais il n'a pas remis en question la présence dans l'idéologie chrétienne de l'idée d'égalité des personnes. (Comme vous le savez, Engels a écrit : « Le christianisme ne connaissait qu'une seule égalité pour tous, à savoir l'égalité du péché originel, qui correspondait pleinement à son caractère de religion des esclaves et des opprimés. ») ;
L'éthique chrétienne, adressée aux classes inférieures de la société, met l'accent sur valeur morale personnalité, indépendante du statut politique ou social d'une personne, et cela manifestait sa nature démocratique;
proclamant la valeur inhérente de la personne humaine, et non des sujets collectifs tels que la famille, le clan, la tribu, l'État, la doctrine chrétienne a dénationalisé la religion. Le Sermon sur la Montagne du Christ, contrairement à la Loi proclamée par Moïse au Sinaï pour le peuple juif, s'adresse à tous ceux qui viennent l'écouter ;
se profilant comme religion mondiale, le christianisme a développé non seulement une autre idée nouvelle, mais a formulé le principe civilisationnel le plus important de la séparation du pouvoir spirituel et politique : a) le terrestre est séparé du céleste ; b) au-dessus des autorités terrestres se tient la plus haute autorité transcendantale ; c) l'individu acquiert un soutien spirituel dans les litiges avec les dirigeants terrestres et l'État lui-même.
Le christianisme s'est opposé au droit absolu de l'État de déterminer le principe le plus élevé selon lequel une personne doit vivre, le devoir absolu des croyants de vivre selon la loi interne de la conscience. Il enseignait qu'il y a quelque chose qui se tient au-dessus de l'État - le commandement de Dieu. La question s'est posée de la relation d'une personne professant le christianisme à l'État, en d'autres termes, la question de la relation de l'Église et de l'État. Alors que l'organisation de l'église était en train de devenir, une telle question ne se posait pas. Mais au IVe siècle. après l'abolition de la persécution des chrétiens et la légalisation du christianisme, vint le temps de l'union de l'église chrétienne et du pouvoir impérial.
En 313, l'empereur Constantin a reconnu le christianisme comme religion d'État de l'Empire romain. Le gouvernement avait besoin d'une seule église avec une seule idéologie. A l'initiative de Constantin, le premier concile œcuménique est convoqué en 325. Des évêques d'Égypte, de Palestine, de Syrie et de Mésopotamie, d'Afrique, des régions d'Asie Mineure, de Grèce, de Perse, d'Arménie et d'autres sont venus à Nicée.
Constantin organisa la notification des évêques différents pays, leur a fourni des moyens de transport, a alloué des ressources matérielles pour la tenue du Conseil, a ouvert une réunion dans l'un de ses palais. Et plus tard, après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et d'Orient en 395, les Conciles se sont tenus à l'initiative des empereurs byzantins, qui les ont souvent présidés et ont donné à leurs décisions un statut d'État.
Au début du Moyen Âge, les Conciles d'Église donnaient le ton à la société chrétienne. Aux Conciles, le dogme religieux a été développé et approuvé, qui avait non seulement une signification purement religieuse, mais aussi politique. La religion étant l'idéologie dominante au Moyen Âge, alors, comme le notait à juste titre F. Engels, "les dogmes de l'Église devinrent en même temps des axiomes politiques, et les textes bibliques reçurent force de loi dans toutes les cours...". .
Il ne faut pas oublier que la formation du dogme religieux a eu lieu dans la lutte la plus acharnée et la plus acharnée. C'était une époque de grands mouvements hérétiques, ou plutôt de grandes fluctuations doctrinales, car l'orthodoxie était encore loin d'être complète. Au cours du IVe siècle. il y avait une sélection des livres sacrés des chrétiens, ainsi que ceux qui ont été déclarés interdits et sujets à destruction.
A cette époque, l'église a attiré les grands penseurs Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome et d'autres pour la servir.En même temps, la formation officielle de la hiérarchie de l'église a eu lieu. Énorme richesse accumulée entre les mains de l'église, elle est devenue le plus grand propriétaire terrien en raison des possessions confisquées des temples païens, de l'achat de terres et des dons.
Au Ve siècle la ville éternelle de Rome, sur le territoire de laquelle aucun ennemi étranger n'avait mis le pied depuis huit siècles, fut prise et pillée par les Goths sous la conduite du roi Alaric (410). L'empire a été capturé par les peuples germaniques, qui ont formé un certain nombre de royaumes sur son territoire.
L'idée de domination théocratique dans les enseignements d'Augustin
politique Moyen Âge d'Aquin théocratique
Une église renforcée devait également avoir une doctrine sur les questions socio-politiques. On retrouve le développement d'une telle doctrine chez Augustin (345-430), l'un des pères de l'Église. Augustin, philosophe, prédicateur influent et homme politique de l'Église catholique, est né en Afrique du Nord. Son père était un patricien romain, un païen, sa mère était chrétienne. Il a étudié à Carthage à l'école de l'éloquence.
Montée sur les hauteurs de la romaine culture païenne(il faisait partie du cercle des personnes proches de la cour impériale), à l'âge de trente ans, il change radicalement de mode de vie, devient chrétien. Il fut ordonné prêtre, puis consacré évêque à Hippone, ville située près de Carthage.
Impressionné par la prise de Rome, Augustin rédige le traité « De la Cité de Dieu » (413-426), dont l'idée principale est de remplacer l'unité de l'empire mondial romain (pouvoir d'État) par l'unité du Église catholique mondiale (catholique - grecque universelle, englobante) (pouvoir spirituel) ). Augustin formule l'idée théocratique de la primauté du pouvoir spirituel sur le séculier.
Le cours de l'histoire humaine, selon Augustin, est prédéterminé par la Providence divine et est une lutte entre les forces de la lumière et des ténèbres. La divinité n'est que la source du bien, le mal découle du libre arbitre, de la lutte pour l'indépendance et de la non-reconnaissance des institutions divines.
Conformément à la lutte des forces de la lumière et des ténèbres, l'histoire du monde tombe également dans deux directions: les adhérents de Dieu sur terre, reconnaissant sa volonté, étant entrés au sein de l'église, construisent la ville de Dieu, et les partisans de Satan construisent un séculier , état terrestre.
Augustin avait une attitude négative envers toute forme de violence, mais il comprenait son inévitabilité dans ce monde. Par conséquent, il a également reconnu la nécessité d'un pouvoir d'État, bien qu'il ait lui-même décrit ses détenteurs comme une "grande bande de voleurs". En liant le royaume du diable à l'État, Augustin a jeté les bases de nombreuses hérésies médiévales. Le sens de l'histoire - selon Augustin - est la victoire du christianisme à l'échelle mondiale.
Papauté et Empire
Deux ou trois siècles après l'effondrement de l'État romain en Europe, de nouvelles forces émergent - la papauté et l'empire. L'évêque de Rome, qui reçut le nom de « pape » dès le VIe siècle, se distingua parmi les autres « princes de l'Église ». La deuxième puissance était le nouvel empire chrétien fondé par le roi franc Charlemagne, qui en 800 fut couronné empereur du "Saint Empire romain" par le pape. Après la mort de son fondateur, l'empire s'est effondré, mais a été restauré au 10ème siècle. comme "Saint Empire romain germanique de la nation allemande".
Sous les réformes du pape Grégoire VII au XIe siècle. l'influence de l'église s'accroît et en même temps se déroule la lutte entre l'empire et la papauté, qui se poursuit avec plus ou moins de succès. Après la division des Églises en 1054 en catholiques et orthodoxes, la direction de la papauté n'est plus contestée par l'Église d'Occident.
En la personne de Grégoire VII, la papauté revendique non seulement l'indépendance vis-à-vis du pouvoir des empereurs, mais aussi la domination sur eux. Dans son activité, le pape a été guidé par l'enseignement de saint Augustin sur la cité de Dieu, qui, dans son essence, est beaucoup plus élevée que la cité de la terre. Pour déterminer la relation entre les autorités spirituelles et laïques, leur comparaison avec le Soleil et la Lune, connue sous le nom de théorie des deux étoiles, a été utilisée.
Les empereurs romains se sont identifiés au Soleil, et certains empereurs médiévaux ont tenté de raviver cette comparaison. Mais depuis l'époque de Grégoire VII, de telles tentatives ont été résolument réprimées.
Les autorités ecclésiastiques ont emprunté l'image de deux luminaires du livre de la Genèse : « Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux... Et Dieu créa deux grands luminaires : un plus grand luminaire, pour contrôler le jour, et un plus petit. luminaire, pour contrôler la nuit.
Pour l'église, le grand luminaire - le Soleil - était le pape, le plus petit luminaire - la Lune - l'empereur ou le roi. Ces symboles significatifs, autour desquels se cristallise le conflit, servent, comme c'est le cas au Moyen Âge, à la fois à la théorie et à l'image.
Une autre image s'est répandue au Moyen Âge, connue sous le nom de théorie des deux épées. L'épée était un symbole de pouvoir. La théorie des deux épées est connue dans différentes interprétations, selon le côté dans le différend entre le pouvoir spirituel et séculier qui a prévalu.
Dans l'interprétation de l'église, le Christ donne au dirigeant spirituel (de l'église) deux épées comme symboles du pouvoir spirituel et séculier. Et le seigneur spirituel lui-même, à son tour, donne une épée au souverain séculier et a donc la primauté sur lui.
La croissance de l'influence politique de la papauté s'est particulièrement clairement manifestée dans l'organisation de croisades en Orient (XI-XIII siècles). Pendant ce temps, l'Église catholique était au zénith de sa puissance et la plus proche de gagner la suprématie sur le pouvoir séculier. Vers la fin du XIIIe siècle. l'église a également pris le dessus sur les mouvements hérétiques.
Hérésies médiévales
Au Moyen Âge, pensée politique et jurisprudence, philosophie et sciences naturelles, tous les « sept arts libres » étaient revêtus d'habits religieux et subordonnés à la théologie. Dans les hérésies - directions religieuses qui s'écartent de la doctrine officielle de l'Église catholique, on peut aussi voir l'opposition socio-politique doctrine.
Il est d'usage de faire la distinction entre les hérésies paléochrétiennes et médiévales. Ces derniers, à leur tour, consistent en des hérésies des XIe-XIIIe siècles. (Pauliciens, Bogomiles, Cathares, Albigeois, etc.) et XIV-XVI siècles. (Lollards, Taborites, Frères Apostoliques, Anabaptistes, etc.). Toutes ces hérésies étaient des mouvements de masse de nature plébéienne-paysanne ou bourgeoise dirigés contre la papauté et le féodalisme.
L'hérésie des Pauliciens, ou Bogomiles, qui ont pénétré de l'Orient, était de la persuasion manichéenne, elle divisait le monde en deux moitiés : pure, spirituelle, divine et pécheresse, matérielle, satanique. La deuxième partie des hérétiques comprenait l'Église catholique, dans laquelle ils voyaient la concentration du mal. Ils s'appelaient Cathares, c'est-à-dire nettoyer.
En France, les Cathares étaient connus sous le nom d'Albigeois (d'après le nom de la ville d'Albi - le centre du mouvement). Les Cathares avaient leur propre clergé, qu'ils faisaient sortir de l'église apostolique, et leurs propres rites.
C'était une anti-église avec une doctrine qui était anti-catholicisme. Dans toutes ces hérésies, le monde matériel était un monde du mal, et non seulement l'église officielle, mais toutes les institutions étatiques étaient reconnues comme le produit de mauvais esprit. Par conséquent, les Cathares et les Albigeois ont refusé de reconnaître les institutions étatiques, le service militaire et de prêter serment.
En plus des hérésies de masse aux XII-XIII siècles. il y avait des hérésies mystiques. Elles n'étaient pas aussi répandues que, par exemple, l'hérésie des Albigeois, contre laquelle le pape déclara une croisade et institua l'Inquisition. Parmi les hérésies mystiques, les plus célèbres sont les Amalricains et les Joachimites.
Les Amalricains (du nom du fondateur du maître parisien de théologie Amalrich Bensky) ont développé des idées mystiques sur l'approche directe des croyants à Dieu. Cela reflétait également le déni de l'importance de l'église, de son pouvoir "sauvant", de son rôle d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Niant tout pouvoir et ordre traditionnel, les Amalricains professaient une sorte d'anarchisme.
Le fondateur de l'hérésie joachimite, le moine Joachim de Flore et ses disciples croyaient que l'église s'était délabrée et, avec le monde existant, devait être condamnée. Elle doit céder nouvelle église les justes, ceux qui sont capables de renoncer à la richesse et d'établir un royaume d'égalité.
Les idées égalitaires des Joachimites étaient très populaires à l'Université de Paris. La plate-forme politique des Lollards, des Taborites et des Frères apostoliques comprenait des revendications pour l'égalité de tous, l'abolition des privilèges de classe, des tribunaux, des guerres et de l'État. Les adeptes de ces mouvements opposent la papauté, le culte magnifique, aux différences entre le clergé et les laïcs.
Les hérésies médiévales ont été la source immédiate de la Réforme et du protestantisme en général.
La doctrine politique de Thomas d'Aquin
le 13ème siècle - le siècle de la plus haute puissance de l'Église romaine. A cette époque, la formation définitive du dogme religieux médiéval a lieu. L'Église le doit au « plus glorieux », « angélique » Thomas d'Aquin (1225 ou 1226 - 1274), qui, en plus de la théologie et de la philosophie, a interprété les problèmes du droit, de la morale, de l'État et de l'économie.
Thomas d'Aquin est né près de Naples, près de la ville d'Aquino, appartenait à une famille aristocratique, était le petit-neveu de Frederick Barbarossa. Thomas est le premier professeur scolastique de l'église ("prince de philosophie"). A étudié à Cologne, Bologne, Rome, Naples. Depuis 1279, il est reconnu comme le philosophe catholique officiel, qui a lié la doctrine chrétienne (en particulier les idées d'Augustin le Bienheureux) à la philosophie d'Aristote.
Dans ses opinions politiques, Thomas a rejeté l'égalité sociale et a soutenu que la division en domaines était établie par Dieu. Toutes sortes d'autorités sur terre viennent de Dieu. « La communauté d'État », écrit-il, « est une préparation à une communauté supérieure, l'État de Dieu. Ainsi, l'État est subordonné à l'Église en tant que moyen pour une fin.
En même temps, il faut faire la distinction entre l'essence, la forme et l'usage du pouvoir. L'autorité établie par Dieu fait du bien aux gens, c'est pourquoi elle doit être obéie sans poser de questions.
La tâche principale du pouvoir d'État est de promouvoir le bien commun, de veiller à la justice dans les affaires publiques et d'assurer la paix pour les sujets. Mais l'utilisation du pouvoir peut être mauvaise. Par conséquent, dans la mesure où le pouvoir séculier viole les lois de Dieu, les sujets ont le droit de lui résister.
L'enseignement de saint Thomas d'Aquin reconnaissait la souveraineté du pouvoir du peuple : « Un roi qui a trahi son devoir ne peut exiger l'obéissance. Ce n'est pas une rébellion visant à renverser le roi ; puisqu'il s'est levé lui-même, le peuple a le droit de le déposer.
Cependant, mieux vaut limiter son pouvoir afin d'éviter les abus. A cette fin, le peuple tout entier doit participer au gouvernement. Le système étatique doit combiner une monarchie limitée et élective avec une aristocratie fondée sur le savoir et une démocratie qui assurerait l'accès au pouvoir de toutes les classes par des élections populaires.
Aucun gouvernement n'a le droit de lever des impôts au-delà de la mesure fixée par le peuple. Tout pouvoir politique s'exerce avec le consentement du peuple et toutes les lois doivent être faites par le peuple ou ses représentants. Nous ne pouvons pas être en sécurité tant que nous dépendons de la volonté d'un autre.
La théorie de la souveraineté du peuple avait des partisans non seulement parmi le parti des Guelfes - le parti ecclésiastique - auquel Thomas appartenait, mais aussi parmi le parti des Gibelins - partisans de l'empire. L'écrivain le plus célèbre du parti Gibelin était Marselius de Padoue (né en 1280, année de mort inconnue).
« Les lois », écrivait-il, « tirent leur autorité du peuple et se flétrissent sans sa sanction... Le monarque, approuvé par la législature et accomplissant sa volonté,... est responsable devant le peuple et est soumis à la loi, et le peuple qui le nomme et lui prescrit des devoirs doit veiller à ce qu'il obéisse à la Constitution et, en cas de violation, l'expulser. Il est significatif que les Formes de Thomas d'Aquin et de Marseilius de Padoue, représentant les belligérants, soient si nombreuses. beaucoup de questions.
Le mérite de F. d'Aquin est le développement de la théorie du droit. L'homme, en tant que citoyen d'un État chrétien, a affaire à quatre sortes de lois : éternelles, naturelles, humaines et divines. La loi éternelle est l'esprit divin qui gouverne l'univers.
La loi éternelle est contenue en Dieu et existe donc par elle-même. Toutes les autres lois sont dérivées et subordonnées à l'éternel. La loi naturelle est le reflet de la loi divine dans l'esprit humain. En raison de l'implication de l'esprit humain dans Esprit divin, l'esprit d'une personne contrôle toutes ses forces morales et est la source de la loi naturelle (il ordonne de faire le bien et d'éviter le mal).
Selon la loi de la loi naturelle, la vie heureuse des gens avant la chute s'est poursuivie. De la loi naturelle découle la loi humaine, créée par la volonté des gens. Le but de la loi humaine doit être le bien commun, ce que Thomas entend de la même manière qu'Aristote : c'est-à-dire des intérêts qui concernent également tous les citoyens.
Les lois humaines sont conçues pour forcer les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Et cet objectif est atteint de trois manières : ordonner, autoriser et interdire. En plus d'être orientée vers le bien commun, la loi doit être émise par l'autorité compétente et promulguée.
Quant au quatrième type de loi, ce sont les lois de l'Ancien et du Nouveau Testament, celles qui conduisent une personne à atteindre la béatitude dans l'au-delà, pour lesquelles la révélation divine est requise en raison de l'insuffisance de la seule raison naturelle.
Les vues du philosophe anglais W. Ockham
Au XIVe siècle. le pouvoir de l'Église, qui avait atteint son apogée au siècle précédent, commença à s'affaiblir, et le pouvoir séculier en la personne des rois augmenta. En Europe, le processus de création d'États-nations centralisés a commencé. Dans ces conditions, des doctrines ont émergé qui remettaient en cause la primauté de la papauté.
Contrairement à Augustin, qui affirmait que le pouvoir séculier venait du diable, ils soutenaient qu'il n'y a de pouvoir que de Dieu. Le pape possède bien une épée, mais cette épée symbolise le pouvoir spirituel : apporter la lumière de la vérité, combattre les hérésies. L'épée du pouvoir séculier est entre les mains des souverains.
Le célèbre philosophe anglais W. Occam (1300-1350) était un partisan de l'indépendance du pouvoir séculier. Il croyait que dans les affaires terrestres, le pouvoir devrait appartenir à l'État et dans les affaires ecclésiastiques - à l'église. Ockham considérait la papauté comme une institution temporaire et croyait que le corps spirituel le plus élevé était la communauté des croyants et le Conseil élu par elle.
Ses opinions politiques anticipaient à bien des égards les idées de la Réforme et les idées clés qui allaient dominer la pensée politique trois ou quatre siècles plus tard. Ainsi, par exemple, Ockham a écrit que dans l'état de nature, tous les gens vivaient sans propriété ni pouvoir, ce qui assurait leur égalité. L'État doit être établi au moyen d'un contrat social. Le but de l'État est le bien commun, protégé par des lois.
Au XIVe siècle. théories démocratiques populaires du droit populaire. Comme on le sait, le système de dépendance vassale qui prévalait au temps de la féodalité établissait les relations suivantes : le souverain, acquérant des droits sur un vassal, était obligé de le protéger.
En conséquence, les théories du droit populaire ont également soutenu qu'il existe un accord entre le monarque et le peuple, et que le peuple, assumant le devoir de soumission, reçoit le droit d'exiger du monarque qu'il gouverne pour le bien du peuple.
Si les monarques violent le traité, alors le peuple a le droit de considérer une telle règle comme une tyrannie et d'y résister. Dans ces théories, non seulement la disposition sur le droit du peuple était exprimée, mais aussi l'idée du droit de lutter contre la tyrannie, qui se répercuterait plus tard dans les enseignements des soi-disant monarchomaques, ou tyrans-combattants.
Mais le droit du peuple s'est avéré être un droit collectif caractéristique du Moyen Âge, le peuple étant considéré comme un tout, et non comme un ensemble d'individus, dont chacun était doté de droits personnels. Et l'idée de l'individualisme et des droits personnels de l'individu est déjà l'idée d'une nouvelle ère.
Conclusion
Comme vous le savez, dans les premiers stades de l'existence de la société, les liens sociaux et le comportement des gens étaient expliqués principalement dans le cadre de la doctrine de l'origine divine. vie humaine: Dieu (démiurge, absolu) détermine complètement l'ordre terrestre, exsudant le pouvoir et commandant une personne. Dans le cadre des relations qu'il établit, le "roi" et le "peuple" sont totalement dépendants de la providence divine. Leur rôle n'était que dans la transmission, l'incarnation de la volonté céleste. Une telle explication surnaturelle de la nature du pouvoir témoigne de l'incapacité de la pensée politique de l'époque à donner une interprétation rationnelle de ce type de réalité, à révéler ses connexions externes et internes.
Une interprétation différente de l'approche théologique a été proposée par Thomas d'Aquin. Le penseur médiéval distingue trois éléments du pouvoir : le principe, la méthode et l'existence. Le principe, selon Thomas d'Aquin, vient de Dieu, et le mode et l'existence du pouvoir dérivent de la loi humaine.
A partir de ce moment, le pouvoir apparaît comme une combinaison de gestion invisible et providentielle et d'efforts humains. Il s'est avéré que Dieu a déterminé les établissements les plus généraux du pouvoir, et sa véritable incarnation a été réalisée par des personnes qui avaient leur propre volonté, avaient leurs propres intérêts, mais agissaient conformément à la volonté de Dieu.
Les opinions politiques de F. Aquinas, M. Padua, V. Occam contredisent l'idée des humanistes italiens sur le Moyen Âge comme une "nuit noire" de l'histoire européenne. Au contraire, F. Schlegel a raison lorsqu'il écrit : « Si le Moyen Âge peut être comparé à une nuit noire, alors cette nuit est étoilée.
Liste de la littérature utilisée
1.Kravchenko A.I. Science politique. M. : Centre d'édition "Académie". 2001. - 345 p. .Moukhaev R.T. Science politique: Un manuel pour les universités. - M. : "Avant-izdat", 2003. - 432 p. .Sciences politiques : Euh. allocation / éd. MA Vasilika - Saint-Pétersbourg, 2000. .Pougatchev V.P. Science politique : Manuel de l'étudiant. - M., 2000. .Sirota P. M. Sciences politiques : Cours magistral, - Saint-Pétersbourg, 2000.
Le fondateur de l'Ordre franciscain mendiant était François d'Assise (1182-1226), fils d'un riche marchand, qui quitta la maison paternelle et renonça à sa propriété. Il a prêché l'amour universel non seulement des gens les uns pour les autres, mais aussi pour tous les êtres vivants, les arbres, les fleurs, la lumière du soleil et le feu, a appris à trouver de la joie dans l'abnégation et l'amour. Il n'est pas surprenant qu'à cette époque dure et impitoyable, le nombre de disciples de François ait augmenté rapidement aux dépens des citadins, des artisans et des pauvres.
Le pape Innocent III et ses successeurs se méfiaient des « petits frères » (minorités), mais ne les persécutaient pas. Ils ont exigé que les disciples de François prononcent officiellement les vœux monastiques, s'unissent et constituent l'Ordre des Moines Mendiants, directement subordonné au pape.
Les rivaux des franciscains étaient les dominicains, ordre mendiant de frères prédicateurs, fondé par le moine espagnol Dominique de Guzman (1170-1224), qui s'illustra dans la lutte contre les hérétiques albigeois. Ses disciples, qui ont choisi comme emblème un chien avec une torche allumée dans la gueule, ont été appelés «chiens du Seigneur» pour une raison (un jeu sur les mots latins domini canes). Ils sont devenus l'épine dorsale des papes dans la lutte contre leurs adversaires politiques. L'une des principales formes de leur activité était la prédication et la polémique avec les hérétiques, soutenant la pureté de la doctrine chrétienne. Du milieu d'eux sont sortis les plus grands théologiens Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Les chaires de théologie des universités passèrent également aux mains des dominicains. Plus que tout autre ordre, les dominicains et les franciscains gravitaient vers l'Orient. Ils pénétrèrent en Russie, dans l'Orient arabe, dans les possessions des Mongols-Tatars, et même en Chine et au Japon.
hérésies médiévales. hérésie début du Moyen Âgeétaient principalement de nature théologique, comme, par exemple, l'arianisme. Pendant cette période, des cas isolés de discours du clergé soutenu par la population locale contre l'église officielle sont connus, mais ils étaient, en règle générale, locaux. L'intensité des espoirs millénaires du peuple, associée à l'attente de l'avènement du "royaume de Dieu" millénaire et ayant sans aucun doute une couleur hérétique, est tombée sur les Xe - début XIe siècles, mais a été quelque peu atténuée par le clunisien réforme.
Les hérésies du Moyen Âge développé avaient un caractère social plus prononcé. Parmi elles, il convient tout d'abord de distinguer deux types d'hérésies : modérer, généré par la protestation croissante des citadins contre l'ordre féodal, le soi-disant bourgeois hérésies du Moyen Âge, et paysan-plébéien, reflétant l'humeur des couches les plus opprimées et les plus pauvres de la société féodale - la plèbe urbaine et la paysannerie pauvre. Les premiers réclamaient l'épuration morale de l'Église, la limitation de ses richesses, la simplification des rituels, l'abolition du clergé en tant que classe privilégiée spéciale, ils opposaient la « vraie foi populaire » à l'enseignement officiel de l'Église, qu'ils vu comme un mensonge et une erreur. La seconde était plus radicale. En fin de compte, ils visaient à établir la propriété et l'égalité sociale et l'abolition des ordres et privilèges féodaux les plus détestés. Il convient de noter que ce « sous-texte » social radical pourrait être présent dans une certaine mesure dans les hérésies bourgeoises, dont les porteurs étaient leurs adhérents les plus défavorisés. Les hérésies paysannes-plébéiennes sont souvent devenues la bannière des soulèvements anti-féodaux de masse, des soulèvements paysans du Moyen Âge.
Au XIe siècle. sous l'influence de l'hérésie des Pauliciens et des Bogomiles, répandue à Byzance et dans la péninsule balkanique, un mouvement est né en France et en Italie patari(patarenov) (ils tirent leur nom du nom du marché de Milan). Ils condamnaient la richesse de l'Église, les vices de ses ministres, la pratique de la vente des indulgences et s'opposaient à l'élite urbaine. Lorsque le prédicateur Arnold de Breshian, un disciple d'Abélard, est apparu dans le nord de l'Italie, s'exprimant contre le clergé et le pape, appelant à la destruction de l'injustice sociale et à la protection des pauvres contre l'oppression des seigneurs féodaux et des citadins riches, de nombreux Pataras rejoignirent ses partisans, des sectes arnoldistes se formèrent. L'Église a traité cruellement la tribune du peuple. Arnold de Brescia a été brûlé sur le bûcher, mais ses idées ont continué à vivre parmi le peuple pendant plusieurs siècles et ses partisans se sont dispersés dans de nombreux pays d'Europe centrale et méridionale.
Au XIIe siècle. l'hérésie dualiste des Cathares ("purs") se généralise, qui couvre tout le sud de la France et en partie les régions du nord de l'Italie. C'était un enseignement manichéen qui absolutisait le rôle du mal dans le monde. Ils considéraient le monde comme un produit des forces des ténèbres, le diable. Les Cathares croyaient qu'au-delà des limites de la vie terrestre, les âmes de tous les peuples s'uniraient dans l'amour fraternel. Ils ont rejeté les institutions de la société, l'État et surtout l'Église. Les Cathares ont proclamé la pureté de la vie et la perfection spirituelle comme objectifs. Ils ont traduit l'évangile en langue vernaculaire et ont rejeté toutes les formes de culte et d'adoration officiels. A la tête des communautés cathares se trouvaient des "parfaits" qui renonçaient à tout tentations mondaines et se sont confiés uniquement au soin de l'approche du royaume de la lumière.
Proche des enseignements des Cathares se trouvait l'hérésie des Vaudois, ou "Pauvre Lyon". Peter Waldo, son fondateur, a qualifié l'église de "figuier stérile" et a appelé à son abolition. Les Vaudois rejetaient la violence et, en rapport avec celle-ci, la guerre, le procès, la peine de mort et la persécution religieuse. Le mouvement vaudois au XIIIe siècle divisé en deux courants. Les plus modérés optèrent pour une alliance avec l'Église catholique. Des représentants de l'aile radicale se sont déplacés vers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie. Ceux qui partaient pour l'Italie formaient une secte de pauvres lombards.
Au XIIe - début du XIIIe siècle. l'hérésie des Albigeois (nom commun des Cathares et des Vaudois, originaires de la ville d'Albi en Languedoc, où leurs prédicateurs ont vaincu des prêtres catholiques dans une dispute) s'est tellement répandue que de nombreux seigneurs féodaux du sud de la France, dont les comtes de Toulouse, le rejoignent. Le pape Innocent III a décidé d'éradiquer cette hérésie. À cette fin, il a utilisé l'Inquisition, mais l'hérésie a continué à se répandre. Ensuite, le pape a appelé les seigneurs féodaux du nord de la France et d'autres pays européens à croiser contre les Albigeois, promettant qu'ils recevraient la propriété des hérétiques détruits en récompense. Motivés moins par le désir de protéger l'église que par le désir de profiter des riches terres du sud, ils se lancent en campagne. Les représailles contre les Albigeois furent cruelles sans précédent. La terre fleurie s'est transformée en désert (voir Ch. 9).
Parmi les mouvements hérétiques bourgeois, une place particulière est occupée par les « hérésies intellectuelles » associées à la croissance de la libre-pensée européenne et à l'essor de la culture urbaine.
La recherche d'une justification rationnelle de la foi et d'autres recherches de l'esprit, assoiffé d'émancipation, étaient considérées par l'Église comme un empiètement sur ses fondements. Ce n'est pas un hasard si parmi les hérétiques qu'elle a condamnés se trouvaient des esprits marquants du Moyen Age, Pierre Abélard, Siger de Brabant, Amaury de Vienne (Chartres). Leurs opinions anti-ecclésiastiques ont trouvé une large réponse parmi les jeunes étudiants, une partie des enseignants des écoles et des universités. Les partisans d'Amory de Vienne se sont unis dans les sectes Amalrikan, qui, à leurs yeux, étaient proches des Cathares, qui ont eu l'idée du "royaume de Dieu sur terre". En 1210, les Amalrikans ont été condamnés par l'Église catholique et leurs chefs ont été condamnés à être brûlés. L'église a abusé des cendres d'Amory de Vienne, décédé plus tôt.
Parmi les hérésies bourgeoises figuraient les enseignements de John Wycliffe et Jan Hus (voir les sections pertinentes du manuel).
Une tendance hérétique radicale particulière est née parmi les franciscains spirituels et s'est ensuite propagée aux sectes des frères pauvres, "Fraticelli", Beguins, etc. Le moine calabrais Joachim Florsky dans son "Evangile éternel" a divisé l'histoire en trois époques" : , dieu le fils et dieu le saint esprit; avec ce dernier, il a identifié le temps du vrai christianisme, la liberté et le bonheur de tous les peuples. Il a soutenu que l'ère du saint-esprit ne serait pas établie au ciel, mais sur la terre. Joachim Florsky a appelé l'église romaine le centre du mal et le trône papal - "un repaire de voleurs". Déjà après la mort de Joachim de Florence, son livre fut condamné comme hérétique, ce qui ne put cependant plus empêcher l'émergence de nouvelles sectes joachimites. Les enseignements du prédicateur calabrais ont été développés par Peter Olivi, qui a ouvertement appelé à des discours contre l'église et l'oppression sociale.
Parmi les spiritualistes est venu le prédicateur populaire Segarelli, qui a été brûlé sur le bûcher en 1300. Son disciple était le chef du soulèvement paysan dans le nord de l'Italie, Dolcino (voir chapitre 12). Le mouvement de Dolcino et des « frères apostoliques » dirigés par Segarelli reflétait le plus pleinement cette forme de « sainteté » paysanne et plébéienne, dans laquelle la pauvreté réelle des masses paysannes et plébéiennes devenait un moyen de ralliement contre l'ordre social existant.
Les enseignements de John Ball et des "pauvres prêtres" des Lollards étaient liés au plus grand soulèvement populaire de Wat Tyler (voir ch. 10). Dans leur bouche, les déclarations du prédicateur réformiste John Wycliffe ont acquis une forte orientation anti-féodale. Un document parlementaire a déclaré qu'ils "erraient de diocèse en diocèse ... dans le but de détruire complètement tout ordre, justice et prudence".
Le terrain d'émergence des hérésies du Moyen Âge était principalement la ville avec sa grande population plébéienne, ainsi que les couches inférieures du monachisme, mécontentes de la sécularisation de l'église. A partir de la ville et du milieu monastique, les hérésies se répandent également parmi les masses paysannes, prenant souvent un caractère radical qui effraie les couches modérées des citadins.
En général, les hérésies incarnaient sous une forme religieuse les sentiments anti-féodaux des masses. Mais seules les hérésies paysannes et plébéiennes radicales ont avancé des revendications pour briser tout le système de relations, éliminer l'exploitation de l'homme par l'homme (par la propagande de l'égalité universelle et même de la communauté de propriété). La plupart des hérésies modérées et bourgeoises se bornaient à prêcher la purification morale, la perfection spirituelle, prônaient des changements plus ou moins importants dans la structure ecclésiale, la dogmatique, des changements partiels dans le système social, sans empiéter sur l'ensemble et souvent éloignant les masses. de la véritable lutte pour une solution, les tâches qui les attendent.
Inquisition. Pour combattre les hérésies, l'Église catholique a créé l'Inquisition. Même à l'aube de son histoire, l'Église considérait la violence acceptable en matière d'établissement et de purification de la foi. Augustin a appelé à une lutte sans compromis contre les hérétiques, faisant appel non seulement à l'Église, mais aussi à l'État. L'empereur Théodose le Grand en 382 a établi pour la première fois l'institution d'enquête (latin - inquisitio, d'où "inquisition") ennemis de l'église et de la religion. Cependant, jusqu'au XIIe siècle la persécution des hérétiques, bien qu'elle prenne parfois des formes cruelles, n'a pas le caractère systématique et destructeur qu'elle acquiert pendant les guerres des Albigeois et après la création par le pape Grégoire IX (1227-1241) des cours d'inquisition - tribunaux sacrés directement subordonnés au pape, et sur le terrain livré aux ordres mendiants, majoritairement dominicains.
Dans un certain nombre de pays, par exemple en Espagne, en France, en Italie, les inquisiteurs sont devenus pour un temps plus forts que les évêques. En cas de désobéissance à l'Inquisition, la malédiction menaçait également les autorités laïques. Comme l'ont ordonné les papes, entre les mains des inquisiteurs "l'épée ne s'est pas desséchée de sang". Les prisons immondes, les tortures monstrueuses, les brimades sophistiquées, les feux de joie (auto da fé) sont devenus de plus en plus courants dans le monde chrétien, qui avait oublié la prédication évangélique de l'amour du prochain et du pardon.
Le zèle des inquisiteurs était souvent alimenté non seulement par le désir de défendre la foi. L'Inquisition devient un moyen de régler des comptes personnels, des intrigues politiques, un enrichissement aux dépens des biens des forçats. La haine de l'Inquisition tomba sur les savants, les philosophes et les artistes, dans l'œuvre desquels l'Église vit des germes de libre-pensée dangereux pour elle-même. L'Inquisition a acquis une ampleur particulière à la fin du Moyen Âge avec sa tristement célèbre "chasse aux sorcières".
Église deXIV- XVdes siècles La chute de la papauté. Une sorte de tournant dans l'histoire de l'Église catholique et de la papauté fut le pontificat de Boniface VIII (1294-1303). Boniface VIII a de nouveau révisé le droit canonique, qui devait renforcer encore le prestige et l'influence du pouvoir papal en Europe. Dans le même but, en 1300, il organise pour la première fois un « Jubilé de l'Église ». De nombreux pèlerins ont afflué à Rome pour sa célébration et d'énormes sommes d'argent ont été collectées. Le pape a proclamé l'absolution pour tous ceux qui sont venus à Rome et a inspiré la vente d'indulgences à grande échelle. Dans les affaires internationales, Boniface a cherché à agir comme l'arbitre suprême et le souverain universel. La suprématie absolue de la papauté sur l'Église et le monde a été confirmée par une bulle spéciale de 1302, mais le vœu pieux y était présenté comme réel. L'anniversaire, célébré avec une splendeur sans précédent, est devenu le point culminant et en même temps le début du coucher du soleil pouvoir papal. Une nouvelle force se levait pour répondre aux revendications de la papauté d'unir l'Europe sous son règne. Cette force était les États centralisés émergents, pour lesquels il y avait un avenir. Même pendant la période de fragmentation féodale et de déclin économique, l'unité de la religion et le pouvoir de la papauté ne suffisaient pas à l'unification politique de l'Europe. La formation d'États-nations a mis fin aux espoirs théocratiques de la papauté, qui se sont transformés en un frein au développement ultérieur de l'Europe.
A la fin du XIIIème siècle. un conflit a éclaté entre le roi français Philippe le Beau et le pape Boniface VIII, qui s'est soldé par la défaite et la mort du pape (voir ch. 9). Le trône papal est alors occupé par l'un des évêques français et, en 1309, la résidence du pape est transférée de Rome à Avignon. La « captivité avignonnaise » des papes dura environ 70 ans et ne se termina qu'en 1377. Durant cette période, les papes furent en fait un instrument entre les mains des rois de France. Par exemple, le pape Clément V (1305-1314) soutint les accusations du roi contre les Templiers et autorisa leur massacre, qui fut causé par des raisons politiques plutôt que religieuses.
La société médiévale a essayé de comprendre et de justifier idéologiquement la situation actuelle. L'idée de l'indépendance du pouvoir séculier vis-à-vis de la papauté a été exprimée par Dante dans la Divine Comédie et l'essai Sur la monarchie. Il a reçu un son particulier dans les soi-disant "hérésies nationales", qui ont préparé le terrain pour la future Réforme. Les discours anti-papaux, fusionnant avec d'anciennes revendications impériales, se sont poursuivis en Allemagne et ont abouti à la lutte de Louis de Bavière avec la papauté.
Un vaste mouvement de réforme de l'Église catholique s'est déroulé dans la seconde moitié du XIVe siècle. En Angleterre. Elle trouva son expression dans l'adoption par le roi et le parlement en 1343, 1351 et 1353. des résolutions proches des décrets correspondants de Philippe le Beau et prévoyant la limitation des frais d'église et l'interdiction de saisir la cour pontificale. Les idées de l'indépendance de l'Église nationale, indépendamment de l'autorité papale, ont inspiré Jan Hus en République tchèque, où au XVe siècle. une véritable guerre populaire éclate.
Le soi-disant Grand Schisme (1378-1417), le plus long schisme de l'histoire de l'Église catholique, est devenu une expression vivante de la crise profonde dans laquelle se trouvait l'Église. La discorde dans la curie et l'intervention des monarques européens ont conduit à l'apparition de deux premiers, puis de trois papes. N'évitant aucun moyen, ils se sont battus pour le trône de St. Pierre. Tous les souverains du monde catholique, les grandes universités, les laïcs furent entraînés dans ce conflit, qui causa un dommage irréparable à l'autorité de Rome.
La recherche d'une issue à la situation actuelle a conduit à l'émergence parmi le haut clergé du soi-disant «mouvement cathédrale», qui a également été activement soutenu par un certain nombre de dirigeants laïcs. Ses idéologues, tels que les scientifiques de l'Université de Paris Pierre d'Ailly, Jean Gerson, et plus tard le cardinal Nicolas de Cues, ont exigé que le pape soit placé sous le contrôle de conseils d'église régulièrement convoqués et qu'il réforme l'église "dirigée et dans les membres" de au-dessus afin de revenir vers elle À la suite de grands efforts, le concile fut convoqué sous les auspices de l'empereur Sigismond dans la ville de Constance en 1414-1418.Eugène IV fit tout pour neutraliser les décisions du concile et rétablir le pouvoir absolu du grand prêtre romain.
Lorsque les partisans du mouvement conciliaire convoquèrent leur nouveau conseil dans la ville de Bâle (1431-1449), qui confirma le principe de la suprématie du conseil sur le pape, annula un certain nombre de versements en faveur de la curie, annonça la convocation régulière des synodes provinciaux, Eugène IV ne reconnaît pas ses décisions. Le conflit fut encore aggravé par le fait qu'Eugène IV décida d'utiliser ses propres armes contre ses adversaires et convoqua son propre concile "alternatif", connu sous le nom de Ferraro-Florentin (1438-1445). Obéissant à la volonté du pape, il condamna le mouvement conciliaire. De plus, après de longues négociations, une union fut conclue entre les catholiques romains et Églises orthodoxes(voir Ch. 17, § 2). Bien que par la suite l'Église grecque et l'Église russe aient rejeté l'union comme contraire à tradition de l'église et intérêts nationaux, elle renforça momentanément la position d'Eugène IV. La longue confrontation entre le pape et le concile de Bâle s'achève en 1449 par la défaite des partisans des réformes. La bulle de 1460 interdit l'appel au concile œcuménique, rétablissant ainsi l'autocratie du pape.
Le mouvement conciliaire, sans atteindre ses objectifs principaux, a néanmoins contribué au renforcement de l'autonomie des Églises de plusieurs pays (France, Angleterre, République tchèque). La victoire de la papauté fut éphémère. Ne permettant pas à l'église d'être réformée d'en haut, son adaptation opportune à des conditions considérablement modifiées, elle, sans s'en rendre compte, s'est dirigée vers un danger beaucoup plus grave que les cathédrales - le mouvement antipapal de masse, la Réforme.
Chapitre 21. Culture médiévale de l'Europe occidentale V-XV siècles.
La culture du Moyen Âge d'Europe occidentale couvre plus de douze siècles du chemin difficile et extrêmement complexe parcouru par les peuples de cette région. À cette époque, les horizons de la culture européenne se sont considérablement élargis, l'unité historique et culturelle de l'Europe s'est formée malgré l'hétérogénéité des processus dans les différentes régions, des nations et des États viables se sont formés, des langues européennes modernes se sont formées, des œuvres ont été créées qui enrichi l'histoire de la culture mondiale, d'importants succès scientifiques et techniques ont été obtenus. . La culture du Moyen Âge - la culture de la formation féodale - est une partie inséparable et naturelle du développement culturel mondial, qui a en même temps son propre contenu profondément original et son apparence originale.
Le début de la formation de la culture médiévale. Le début du Moyen Âge est parfois appelé «l'âge des ténèbres», donnant une certaine connotation péjorative à ce concept. Déclin et barbarie, dans lesquels plonge rapidement l'Occident à la fin des Ve-VIIe siècles. à la suite de conquêtes barbares et de guerres incessantes, ils s'opposent non seulement aux acquis de la civilisation romaine, mais aussi à la vie spirituelle de Byzance, qui n'a pas survécu à un tournant aussi tragique dans le passage de l'Antiquité au Moyen Âge. Et pourtant, il est impossible de supprimer cette époque de l'histoire culturelle de l'Europe, car c'est pendant la période du haut Moyen Âge que les tâches cardinales qui ont déterminé son avenir ont été résolues. Le premier et le plus important d'entre eux est la pose des fondations de la civilisation européenne, car dans les temps anciens il n'y avait pas d'"Europe" en compréhension moderne comme une sorte de communauté culturelle et historique avec un destin commun dans l'histoire du monde. Elle a commencé à prendre véritablement forme ethniquement, politiquement, économiquement et culturellement au début du Moyen Âge, fruit de l'activité vitale de nombreux peuples qui ont longtemps habité l'Europe et y sont revenus : Grecs, Romains, Celtes, Germains, Slaves, etc. .le Moyen Âge, qui n'a pas produit des réalisations comparables aux sommets de la culture antique ou du Moyen Âge mûr, a marqué le début d'une véritable histoire culturelle européenne, qui s'est développée sur la base de l'interaction de l'héritage du monde antique, plus précisément, la civilisation en décomposition de l'Empire romain, le christianisme généré par lui, et, d'autre part, les cultures tribales, folkloriques et barbares. Ce fut un processus de synthèse douloureuse, né de la fusion de principes contradictoires, parfois mutuellement exclusifs, la recherche non seulement de nouveaux contenus, mais aussi de nouvelles formes de culture, le transfert du relais du développement culturel à ses nouveaux porteurs.
Même à la fin de l'Antiquité, le christianisme est devenu cette coquille unificatrice dans laquelle une variété de points de vue, d'idées et d'humeurs pouvaient s'intégrer - des doctrines théologiques subtiles aux superstitions païennes et aux rites barbares. En substance, le christianisme pendant la transition de l'Antiquité au Moyen Âge était une forme très réceptive (jusqu'à certaines limites) qui répondait aux besoins de la conscience de masse de l'époque. Ce fut l'une des raisons les plus importantes de son renforcement progressif, de son absorption d'autres phénomènes idéologiques et culturels et de leur combinaison dans une structure relativement unifiée. À cet égard, l'activité du père de l'Église, le plus grand théologien, l'évêque Aurèle Augustin d'Hippone, dont l'œuvre multiforme a essentiellement tracé les limites de l'espace spirituel du Moyen Âge jusqu'au XIIIe siècle, lorsque le système théologique de Thomas d'Aquin a été créé, était d'une grande importance pour le Moyen Âge. Augustin appartient à la justification la plus cohérente du dogme sur le rôle de l'église, qui est devenu la base du catholicisme médiéval, la philosophie chrétienne de l'histoire, développée par lui dans l'essai "Sur la Cité de Dieu", en psychologie chrétienne. Avant les Confessions augustiniennes, la littérature grecque et latine ne connaissait pas une introspection aussi profonde et une pénétration aussi profonde dans le monde intérieur de l'homme. Les écrits philosophiques et pédagogiques d'Augustin étaient d'une valeur considérable pour la culture médiévale.
Pour comprendre la genèse de la culture médiévale, il est important de tenir compte du fait qu'elle s'est principalement formée dans la région où se trouvait jusqu'à récemment le centre d'une civilisation romaine puissante et universaliste, qui ne pouvait disparaître historiquement d'un coup, tandis que les relations sociales et les institutions, la culture générée par elle, continuaient d'exister. , les gens nourris par elle étaient vivants. Même dans les moments les plus difficiles pour l'Europe occidentale, la tradition de l'école romaine ne s'est pas arrêtée. Le Moyen Âge a adopté un élément aussi important que le système des sept arts libéraux, divisé en deux niveaux : le plus bas, le primaire - trivium, qui comprenait la grammaire, la dialectique, la rhétorique, et le plus élevé - le quadrivium, qui comprenait l'arithmétique, la géométrie, la musique et astronomie. L'un des manuels les plus courants au Moyen Âge a été créé par un néoplatonicien africain du 5ème siècle avant JC. Marcien Capella. C'était son essai Sur le mariage de la philologie et de Mercure. Le moyen le plus important de continuité culturelle entre l'Antiquité et le Moyen Âge était la langue latine, qui a conservé son importance en tant que langue du travail de l'église et de l'État, de la communication et de la culture internationales, et a servi de base aux langues romanes ultérieures.
Les phénomènes les plus frappants dans la culture de la fin du 5ème - la première moitié du 7ème siècle. associé à l'assimilation de l'héritage ancien, qui est devenu un terreau pour la renaissance de la vie culturelle en Italie Ostrogoth et en Espagne Wisigoth.
Le maître des offices (premier ministre) du roi Ostrogoth Theodoric Severinus Boethius (vers 480-525) est l'un des professeurs les plus vénérés du Moyen Âge. Ses traités d'arithmétique et de musique, ses écrits de logique et de théologie, ses traductions des œuvres logiques d'Aristote sont devenus le fondement du système médiéval d'éducation et de philosophie. Boèce est souvent qualifié de "père de la scolastique". La brillante carrière de Boèce est brusquement interrompue. Sur une fausse dénonciation, il fut jeté en prison puis exécuté. Avant sa mort, il écrivit un petit essai en vers et en prose "Sur la consolation de la philosophie", qui devint l'un des ouvrages les plus lus du Moyen Âge et de la Renaissance.
L'idée de combiner théologie chrétienne et culture rhétorique a déterminé la direction de l'activité du questeur (secrétaire) et du maître des offices des rois Ostrogoths, Flavius Cassiodorus (c. 490 - c. 585). Il a élaboré des plans pour la création de la première université en Occident, qui, malheureusement, n'étaient pas destinés à se réaliser. Il a écrit Varia, une collection unique de documents, de correspondance commerciale et diplomatique, qui est devenue un modèle de style latin pendant de nombreux siècles. Dans le sud de l'Italie, sur son domaine, Cassiodore a fondé le monastère de Vivarium - un centre culturel qui réunissait une école, un atelier de copie de livres (scriptorium), bibliothèque. Le vivarium est devenu un modèle pour les monastères bénédictins qui, à partir de la seconde moitié du VIe siècle. devenir les gardiens de la tradition culturelle en Occident jusqu'à l'ère du Moyen Âge développé. Parmi eux, le monastère de Montecassino en Italie était le plus célèbre.
L'Espagne wisigothique a mis en avant l'un des plus grands éducateurs du haut Moyen Âge, Isidore de Séville (vers 570-636), qui s'est fait connaître comme le premier encyclopédiste médiéval. Son œuvre principale "Etymologie" en 20 livres est une collection de ce qui a été préservé des connaissances anciennes.
Cependant, il ne faut pas croire que l'assimilation de l'héritage antique s'est faite librement et à grande échelle. La continuité dans la culture de cette époque n'était pas et ne pouvait pas être une continuité complète des réalisations de l'antiquité classique. La lutte consistait à ne sauver qu'une partie insignifiante des valeurs culturelles et des connaissances survivantes de l'époque précédente. Mais c'était aussi extrêmement important pour la formation de la culture médiévale, car ce qui était préservé était une partie importante de sa fondation et cachait les possibilités développement créatif qui ont été mis en œuvre plus tard.
/ En dessous deéd. J. Duby et M. Perrot ; éd. volumes K. Klapisch-Zuber / Per. à partir de fr. en dessous deéd ...Dans les conditions de la domination de la vision religieuse du monde et du rôle dirigeant de l'Église, tout désaccord avec l'ordre existant signifiait un discours contre "l'ordre de Dieu" et signifiait hérésie- faux enseignement, déviation de la religion officielle. Des hérésies sont apparues lorsque l'Église chrétienne est devenue une Église d'État, s'est retirée de sa simplicité originelle, de la démocratie et de la pauvreté, et la croissance de l'éducation et de la croissance économique à partir du XIIIe siècle, qui a ravivé l'intérêt pour le droit romain, a montré qu'il existe une justice plus juste que l'Église. Justice.
La formation des opinions hérétiques a été influencée Manichéisme- une religion née au IIIe siècle. en Iran sassanide et s'est propagé de la Chine à Rome. Dans son enseignement, Mani partait de l'idée dualiste de la lutte de la Lumière (bien) avec les Ténèbres (mal) : lors de sa rencontre avec les Ténèbres, la Lumière tombait dans les fers. Le monde qui est tombé au pouvoir des ténèbres n'a pas pu être sauvé. Il ne pouvait qu'être détruit. Ce n'est qu'alors que la Lumière sera libérée des chaînes.
Les affaires mondaines et terrestres sont au pouvoir du dieu des ténèbres. Par conséquent, les personnes dans la vie terrestre ne peuvent pas être engagées dans les affaires du monde, avoir leur propre maison, famille, propriété, elles doivent observer la chasteté et l'abstinence afin d'atteindre la perfection et d'entrer dans le royaume de la Lumière après la mort. Mais l'ascèse est pour les élus (parfaits). Les classes inférieures sont les "écoutants" qui ont été autorisés à avoir leur propre maison, propriété, famille et vaquer à leurs occupations. Mais ils devaient nourrir, héberger les « parfaits » (les prêcheurs du manichéisme). Seulement avant la mort, pour que l'âme de "l'écoute" entre dans le royaume de la Lumière, il devait prendre l'initiation au "parfait".
En 282, l'empereur Dioclétien ordonna que "l'enseignement de ce persan" soit interdit dans l'Empire romain. Mais après la reconnaissance du christianisme comme religion dominante à Rome (IVe siècle), le manichéisme s'est largement répandu et ses adhérents se sont disputés avec l'église officielle.
Le christianisme, contrairement au manichéisme, procède de l'idée de l'intégrité du monde de Dieu. Bien que l'idée d'une lutte entre le bien et le mal, la présence du diable relève du même dualisme païen que le manichéisme. Certains enseignements hérétiques provenaient du manichéisme, d'autres s'inspiraient de divers textes canonisés lorsqu'ils étaient en conflit avec la pratique de l'Église. Cela s'applique particulièrement à apocalypse- la partie la plus complexe du Nouveau Testament construite sur les allégories et le symbolisme
Dans divers enseignements hérétiques du début du Moyen Âge, cette idée a été réfractée de différentes manières. Par exemple, la Byzantine paulicien c'est une lutte entre le bien et le mal, qui était associée à la richesse et à l'exploitation qui lui était associée. Des Pauliciens cette idée passa aux Bogomilesà la Bulgarie. Contrairement aux manichéens, ils ont, comme les pauliciens, appelé les classes inférieures à désobéir à leurs maîtres. Aux XIIIe-XIVe siècles. les bogomiles se retirent de la lutte sociale et, dans le cadre des sectes urbaines, polémiquent avec l'église officielle. Les idées de ces enseignements ont formé la base Mouvement albigeois, né dans le sud de la France au XIIe siècle.
Les mouvements hérétiques les plus massifs se font en Europe avec le développement des villes. Selon les caractéristiques sociales, les hérésies médiévales étaient divisées en bourgeois et paysans-plébéiens. L'opposition bourgeoise à l'église officielle était modérée. Les citadins exigeaient généralement une église bon marché: l'élimination des privilèges coûteux du clergé, la simplification des rites religieux coûteux. Changer la structure sociale n'était pas pertinent pour eux, même si l'ordre féodal interférait avec les activités économiques des citadins. De plus, les bourgeois soutenaient généralement les nobles qui prônaient la sécularisation et la limitation de l'influence politique du clergé (par exemple, quilleurs en République tchèque).
Les hérésies paysannes-plébéiennes, qui réclamaient l'établissement de l'égalité sociale et, par conséquent, étaient dirigées contre l'ordre féodal, avaient une plus grande orientation sociale. L'idéal dans leurs enseignements était l'ordre communautaire. Par conséquent, au cœur de tous ces enseignements hérétiques se trouve la demande d'un retour à la simplicité, à l'ascétisme et à la démocratie des premiers chrétiens ( Pauliciens, les lollards En Angleterre, Taborites en République tchèque). Ils ont souligné que l'inégalité et l'exploitation contredisent les principaux dogmes chrétiens (sur l'égalité de tous devant Dieu, sur l'amour du prochain, etc.).
Il y avait de sérieuses différences dogmatiques entre les divers enseignements hérétiques. Mais tous étaient unis par une attitude fortement négative envers le clergé catholique, dirigé par le pape, en l'opposant aux premiers justes chrétiens, « évangéliques ». Presque tous les enseignements hérétiques procédaient du droit de chaque croyant de comprendre lui-même le christianisme sans l'aide du clergé, ils s'opposaient à l'inégalité entre les laïcs et le clergé en communion, et contre la vente des indulgences. La seule source de foi était Sainte Bible, dont une partie était l'évangile. Sainteté et infaillibilité tradition sacrée- Les établissements des conseils d'église, les écrits des hiérarques d'église, les décrets et les bulles des papes - ont été rejetés.
Dès le XIIe siècle les hérésies, en tant que reflet du désir naissant de diversité spirituelle et de changement social, sont devenues un élément permanent de la vie européenne. C'était une protestation contre la volonté de l'Église officielle de préserver l'unanimité et l'inviolabilité de l'ordre socio-politique établi. La plus grande distribution aux XIIe-XIIIe siècles. des mouvements hérétiques ont atteint le sud de la France, en Provence, ce qui n'est pas un hasard. Ici, les enseignements des Cathares et des Vaudois se sont répandus.
Cathares(grec kataros - pur) étaient proches du bogomilisme (paulicisme) et des manichéens. Ils ont nié la divinité du Christ, le considérant comme un ange. L'essentiel pour eux est la lutte entre le bien et le mal, le monde spirituel avec le physique, créé par Satan, le diable.
Les premiers cathares étaient des missionnaires venus d'Orient, venus lors de la seconde croisade, entre 1140-1150. - les ascètes qui vivaient de l'aumône, en toute chasteté, condamnant le péché charnel en toutes circonstances. Contrairement à l'Église officielle et à de nombreuses hérésies, les Cathares reconnaissaient l'égalité des sexes, ce qui attirait grand nombre femmes. Le nombre de cathares comprenait non seulement des paysans et des classes inférieures urbaines, mais aussi des seigneurs féodaux mécontents de l'église officielle et de la politique de centralisation des rois de France, ainsi que des bourgeois. Mais si les Cathares avaient gagné, leur ascèse fanatique aurait conduit à la destruction des acquis de la culture matérielle. Ils étaient contre l'amélioration de la vie, qui conduisait, en fait, à la primitivité ; cela a contribué au déclin progressif de la secte. Le catharisme s'est répandu en Allemagne de l'Ouest, en Bourgogne, dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie, souvent en combinaison avec Vaudoisisme.
Fondateur de l'hérésie vaudoise Pierre(Pierre) Wald- prônaient également l'ascèse, l'opposant à la promiscuité du clergé officiel. Menant leurs sermons à l'extérieur de l'église, seuls, les Vaudois ont abandonné toute la structure et les rituels religieux officiels, ont rejeté les dîmes et les impôts, l'accomplissement des devoirs de l'État et de l'église. Ils étaient pour la restauration de la pureté évangélique, pour la soumission uniquement aux "bons" prêtres.
Dans le sud de la France, les Cathares et les Vaudois étaient souvent appelés Albigeois car M. Albi devint un des foyers de ces hérésies. Même si les différences entre les deux enseignements étaient importantes. Si les Vaudois procédaient de la reconnaissance du droit de prêcher en dehors de l'Église officielle (comme ce fut le cas en christianisme primitif), opposés au statut du clergé officiel, les cathares étaient plus proches d'une image dualiste dans l'esprit des manichéens, ils étaient également divisés en "parfaits" (ascètes) et "croyants", c'est-à-dire qu'ils dépassaient le christianisme.
Naturellement, les hérésies ont provoqué une vive rebuffade de la part de l'Église catholique. L'un des moyens les plus efficaces de lutter pour le troupeau a été la création de soi-disant ordres monastiques mendiants qui a adopté l'une des principales exigences des hérétiques - la pauvreté comme forme de vie. C'étaient des commandes Dominicains et franciscains, surnommés militants pour le caractère actif et offensif de leurs activités. En quête de popularité, ils ont commencé à autoriser les sermons dans les langues maternelles de leurs ouailles.
L'ordre dominicain en 1216 a fondé un chanoine espagnol instruit (prêtre dans une grande cathédrale) Dominique de Guzman(1170-1221) pour combattre les hérésies dans le sud de la France. Fondateur de l'Ordre des Franciscains, fils d'un riche marchand italien François d'Assise(1181 / 82-1226) a agi, au contraire, presque comme un hérétique - avec la critique de la pratique de l'église et avec la prédication de la pauvreté. Les idées de pauvreté apostolique tombèrent rapidement en désuétude. Le besoin de propriété se révéla irrésistible et les ordres mendiants devinrent bientôt très riches. En général, l'idéal du Nouveau Testament avec l'égalité dans la communauté et la pauvreté apostolique ne s'accordait pas bien avec vrai vie, avec la propriété de la propriété privée.
L'apogée de la lutte de la papauté contre les hérésies médiévales fut inquisition, introduite au XIe siècle. lors des guerres des Albigeois contre les hérétiques du sud de la France. Si l'ordre franciscain prêchait l'humilité et l'humilité, alors les dominicains visaient à l'origine à éradiquer les hérésies et s'appelaient eux-mêmes "chiens du Seigneur". En 1232, ils sont chargés de s'occuper des affaires inquisitoires. La peine la plus légère est un blâme et un avertissement. Mais généralement, les accusés étaient punis de prison et de confiscation des biens. Cela a été particulièrement bénéfique à la fois pour l'église et les rois en difficulté financière. Par conséquent, la volonté de condamner les riches est perceptible (un exemple frappant est la condamnation des Templiers en France au début du XIVe siècle).
En conséquence, l'église, dans la lutte contre la dissidence, a contribué au durcissement des lois laïques. Le manque de contrôle des tribunaux a corrompu l'église en tant qu'organisation. Le déni de culpabilité était déclaré persévérance dans l'hérésie et était passible de la peine de mort. Depuis que l'église déclara qu'elle abhorrait le sang, à partir de 1231 les hérétiques furent exécutés par le feu. Au total, 9 à 12 millions de malheureux ont été exécutés par l'Inquisition en Europe. Dès la fin du XVe siècle la plus active fut l'Inquisition en Espagne. L'incendie et l'expulsion d'environ 3 millions de personnes de ce pays ont contribué à son déclin économique au XVIe siècle. Seulement au XIXe siècle l'inquisition a perdu sa signification et s'est transformée en une "congrégation de l'office pontifical".
Selon l'orientation sociale, on peut distinguer deux principaux types d'hérésies médiévales - bourgeoise et paysanne-plébéienne. L'hérésie bourgeoise exprimait la protestation des citadins contre les entraves féodales qui entravaient le développement de l'économie urbaine et l'oppression des bourgeois par la société féodale. Engels a appelé cette tendance "l'hérésie officielle du Moyen Âge". C'est à lui qu'appartiennent la plupart des mouvements hérétiques des XIIe-XIIIe siècles. Les exigences de telles hérésies prévoyaient l'élimination de la position spéciale du clergé, les revendications politiques de la papauté et la richesse foncière de l'église. Ils ont cherché à simplifier et à réduire le coût des rituels et à améliorer le caractère moral du clergé. L'idéal de ces hérétiques était l'église chrétienne "apostolique" primitive - simple, "bon marché" et "propre". Les hérésies de ce type ne parlaient que contre le « féodalisme ecclésiastique » et n'affectaient pas les fondements du système féodal dans son ensemble. Par conséquent, des groupes entiers de seigneurs féodaux les ont parfois rejoints, essayant d'utiliser l'hérésie bourgeoise dans leur propre intérêt (dans le but de séculariser la propriété de l'église ou de limiter l'influence politique de la papauté). Il en était ainsi à l'époque des guerres des Albigeois dans le sud de la France, des guerres hussites en Bohême, à l'époque de Wyclif en Angleterre.
Beaucoup plus radicales étaient les hérésies paysannes-plébéiennes, reflétant l'attitude hostile des classes inférieures dépossédées de la ville et du village non seulement envers l'église et le clergé, mais aussi envers les seigneurs féodaux, les riches marchands et le patriciat urbain. Partageant toutes les revendications religieuses de l'hérésie bourgeoise, l'hérésie paysanne-plébéienne exigeait également l'égalité entre les peuples. L'égalité civile découlait de l'égalité devant Dieu, niant ainsi les différences de classe. Les hérésies paysannes-plébéiennes, en règle générale, exigeaient également l'abolition du servage et de la corvée, tandis que les sectes extrêmes individuelles appelaient à l'établissement de l'égalité de propriété et de la communauté de propriété. Aux XIVe-XVe siècles. les hérésies paysannes-plébéiennes les plus radicales s'accompagnent souvent de soulèvements populaires (apôtres, Lollards, Taborites, etc.).
En même temps, tout au long du Moyen Âge, il y avait aussi de telles hérésies dans lesquelles les éléments de ces deux courants - les bourgeois et les paysans-plébéiens - n'étaient pas clairement distingués.
Le dogme des enseignements hérétiques médiévaux était assez diversifié, mais les idées principales et les dispositions étaient communes à de nombreuses sectes. Il s'agit, tout d'abord, d'une attitude vivement critique à l'égard des prêtres catholiques de tous rangs, y compris le pape, caractéristique de toutes les sectes et de tous leurs membres, quelle que soit la couche sociale à laquelle ils appartiennent. La principale méthode de critique du clergé était l'opposition du comportement réel des prêtres à l'image idéale du berger biblique, leurs paroles et sermons à la pratique quotidienne. Les indulgences, l'exigence d'un serment sur la Bible et la communion séparée pour les laïcs et pour le clergé ont également été vivement attaquées par la majorité des hérétiques. Les hérétiques de nombreuses sectes appelaient l'église la "prostituée de Babylone", la création de Satan, et le pape - son vicaire, l'Antéchrist. Dans le même temps, une partie plus modérée des hérétiques se considérait comme de vrais catholiques, cherchant à aider à corriger l'église. Une autre partie, non moins importante, rompt ouvertement avec l'Église catholique, créant ses propres organisations religieuses (cathares, vaudois, apostoliques, taborites) ; les plus radicaux d'entre eux (surtout les Apostoliques, les Lollards du XIVe siècle) ont transféré leur attitude hostile envers l'Église catholique à l'ensemble du système social féodal.
La grande majorité des enseignements hérétiques se caractérisent également par le désir de suivre l'Evangile, le reconnaissant comme la seule source de la foi, par opposition aux écrits des "pères de l'Eglise", décisions des conciles, bulles papales, etc. peut s'expliquer par le fait que de toute la littérature chrétienne, seul l'Evangile a conservé quelques vestiges des idées originales rebelles-démocratiques du christianisme primitif. Ils ont servi de base à de nombreux enseignements hérétiques. L'une des idées les plus populaires dans les cercles hérétiques glanées dans l'Évangile était l'idée de "pauvreté apostolique", qui attirait la sympathie de personnes appartenant à diverses couches de la société. Beaucoup d'entre eux vendirent ou donnèrent leurs biens et menèrent une vie ascétique. Mais l'idéal de pauvreté était compris de différentes manières par les hérétiques de divers groupes sociaux : les représentants de la classe dirigeante y voyaient un moyen d'affaiblir rôle politique les églises et la possibilité de profiter de ses richesses ; bourgeois - le moyen de créer une église "bon marché" qui ne nécessite pas de fonds importants de la part des paroissiens. L'attitude des larges masses laborieuses à l'égard de l'idéal de pauvreté était contradictoire. D'une part, l'idée de pauvreté, égalisant tout le monde devant Dieu, affirmant la dignité des pauvres ordinaires, était extrêmement populaire parmi eux; d'autre part, cela n'a pas permis de sortir de leur situation difficile. Par conséquent, parmi les participants aux hérésies paysannes-plébéiennes, les idées de communauté et d'égalité de propriété, qui impliquaient de profonds changements sociaux, se sont également répandues. Grande importance avait l'idéal de l'ascétisme, étroitement associé à la prédication de la pauvreté. L'ascèse révolutionnaire des masses paysannes plébéiennes de cette époque, qui séparait les pauvres et les privés de leurs droits du reste de la société, était, selon Engels, un moyen d'unir les masses opprimées et une forme spécifique de leur conscience de soi.
Les idées mystiques étaient également influentes parmi les hérétiques. Le mysticisme dans les hérésies médiévales est apparu sous deux formes principales. Interprétant les dénonciations et les prophéties bibliques à leur manière, en particulier les visions de l'Apocalypse, de nombreux hérésiarques - Joachim de Calabre, Dolcino et d'autres - ont non seulement prédit un changement inévitable dans l'ordre existant, mais ont également appelé les dates proches de ce coup d'État. De telles prophéties étaient de nature radicale, répondant aux humeurs révolutionnaires des cercles paysans-plébéiens d'hérétiques. Ils étaient associés aux idées "millénaristes" ou "chiliastiques" caractéristiques de ces cercles - sur le début imminent du "royaume millénaire" de la justice, en d'autres termes, du "royaume de Dieu" sur Terre. La tendance bourgeoise du mysticisme, basée sur les enseignements des théologiens allemands du XIVe siècle, avait un caractère différent. - Eckart, Tauler, etc. Eux et leurs partisans croyaient que la "vérité divine" est contenue dans la personne elle-même, qui a donc un "libre arbitre" et doit être créativement active. Ils se caractérisaient par des éléments de panthéisme, qui les conduisaient à l'idée de l'inutilité de l'église. Dans le même temps, ce type de mysticisme se caractérisait par une retraite dans le monde intérieur d'une personne, une extase religieuse, des visions, etc., qui réduisait fortement le radicalisme de ces enseignements et éloignait leurs partisans de la vie réelle et de la lutte.
Le rôle historique des hérésies au Moyen Âge était qu'elles sapaient l'autorité et les préceptes spirituels de l'Église catholique et la vision du monde de l'église féodale qu'elle défendait, exposaient la cupidité et la débauche du clergé et contribuaient objectivement à la propagation de la libre pensée ( bien que les hérétiques eux-mêmes ne fassent le plus souvent pas preuve de libre-pensée, ils se caractérisent par le fanatisme et l'intolérance envers les dissidents).
Puisque les hérésies, bien que sous une forme religieuse, exprimaient les sentiments anti-féodaux des masses, elles ébranlaient également le système féodal dans son ensemble. Cependant, la majorité des sectes, à l'exception des sectes paysannes-plébéiennes prononcées, n'ont généralement pas présenté de revendications ouvertes pour des transformations sociales radicales, l'élimination de l'exploitation féodale. Ils se bornaient à prêcher des changements plus ou moins radicaux dans le dogme ou l'organisation de l'Église. Ils ont opposé la « mauvaise » église et la « fausse » foi à la « bonne » église et la « vraie » foi. Ainsi, les hérésies dans la plupart des cas ont conduit les masses dans le domaine des inventions fantastiques, les ont détournées de la résolution de problèmes réels.
Chapitre 7
hérésies médiévales sectes
Gnosticisme et manichéismeBasilide, Valentin, Marcion Mani(lat. Manichéus
Bogomilisme Pataréna Albigeois, Pauliciens Vaudois
cathares . dualiste monarchique Lucifer ou Satan
John Wycliffe Jean Hus (1371 – 1415).
En même temps, chacun d'eux forge sa propre doctrine politique, en fonction des spécificités de la situation de son pays et de son époque. J. Wycliffe, en particulier, a insisté sur l'indépendance de l'Église anglaise vis-à-vis de la Curie romaine, a contesté le principe de l'infaillibilité des papes et s'est opposé à l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État. Proche du roi Richard 2, il devient l'idéologue du mouvement pour la resubordination de l'Église au roi. Ses idées les plus radicales (sur la propriété en tant que produit du péché) n'ont pas été acceptées et, après sa mort, ses restes ont été confisqués et brûlés sur le bûcher.
Mouvements hérétiques paysans-plébéiens des XIVe-XVe siècles. ont été représentés dans l'histoire par des performances Lollards La rébellion de Wat Tyler
VOIR PLUS:
V l'Europe médiévale appelé hérésie doctrine religieuse, reconnaissant les idées de base (dogmes) du christianisme, mais les comprenant et les interprétant différemment de l'église dominante. Tous les hérétiques se considéraient comme de vrais chrétiens et s'opposaient tout d'abord au clergé et à l'Église qui, à leur avis, pervertissaient le véritable enseignement du Christ. L'Église, à son tour,
accusaient les hérétiques de mal interpréter les textes de l'Ecriture Sainte, d'emprunter les idées des religions étrangères, ou de répéter des idées hérétiques déjà condamnées par les conciles ecclésiastiques. De nombreuses hérésies étaient purement théologiques et ne concernaient pas les problèmes socio-politiques. Cependant, même de telles hérésies, s'étant généralisées, sont devenues dangereuses pour l'autorité de l'église dirigeante, qui a cherché et trouvé le soutien des autorités laïques dans l'extermination des non-croyants. Plus dangereuses encore pour l'Église étaient les hérésies qui, faisant appel aux textes du Nouveau Testament, accusaient le clergé de s'écarter des règles apostoliques, de cupidité, de parasitisme, d'orgueil et d'arrogance exorbitants et de négligence des commandements du Christ. Enfin, un certain nombre d'enseignements et de mouvements hérétiques avaient un caractère anti-féodal, condamnant non seulement l'Église, mais aussi le servage, les nobles privilèges, l'État et la loi.
Les premiers hérétiques de l'Europe, qui ont jeté les bases d'un vaste mouvement socio-politique, ont été Bogomiles bulgares.
Introduction du christianisme en Bulgarie (864), création Ecriture slave et la distribution des livres religieux a coïncidé avec une période de développement rapide des relations féodales. La transition brusque et violente de la société bulgare du système communal-patriarcal au système féodal, la saisie des terres paysannes par le tsar, les boyards, les serviteurs royaux, l'église, le fardeau des paysans appauvris avec une masse de les devoirs en faveur des riches ont fait naître un doute massif sur le fait que tout cela se produisait par la volonté de Dieu, qui est bon et juste. La confirmation de ces doutes a été trouvée dans le Nouveau Testament, au tout début duquel il est dit que tous les royaumes de ce monde n'appartiennent pas à un dieu bon, mais à un diable mauvais. Voici ce que disent les évangiles à propos de la tentation du Christ : « Et l'ayant conduit sur une haute montagne, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers, et le diable lui dit : Je te donnerai le pouvoir sur tous ces royaumes et leur gloire, car elle m'est dévouée, et moi, à qui je veux, je le donne; donc, si vous vous prosternez devant moi, alors tout sera à vous.
Les hérétiques bulgares ont trouvé de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui opposent Dieu et le monde, l'esprit et la chair, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Ils ont prêté une attention particulière aux textes des évangiles, qui permettent d'identifier le diable à la richesse : « Nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il aura du zèle pour l'un et négligera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon (la richesse)". De cela, les Bogomiles ont conclu que la richesse est le diable (un dieu maléfique). Dans les légendes bogomiles, communes à tous les pays slaves, il est décrit au sens figuré comment le diable, lorsqu'Adam, expulsé du paradis, a commencé à labourer la terre, lui a pris un "enregistrement de servitude" - sur lui et sur toute sa progéniture, depuis le la terre a été appropriée par eux, le diable. Depuis lors, les paysans sont asservis aux serviteurs du diable qui se sont emparés des terres arables.
Dans les enseignements des Bogomiles, il y a aussi beaucoup de saine logique paysanne : qui est content de voir la croix sur laquelle le fils de Dieu a été exécuté ? Bien sûr, pas à Dieu, mais au diable ; donc, les riches se décorent de croix - instruments d'exécution, surtout l'église, qui s'est vendue au diable.
Les Bogomiles ont accusé l'église et le clergé riches en croissance rapide de servir le diable. À propos des traditions, des chartes et des rituels de l'église, ils ont dit: "Ce n'est pas écrit dans l'évangile, mais établi par les gens." De tous les rites, les Bogomiles ne reconnaissaient que le jeûne, la confession mutuelle et la prière "Notre Père".
Les Bogomiles ont soutenu que la domination de la richesse et de la violence, la servitude féodale, le monde du mal, comme il est dit dans l'Écriture, est proche de la fin : « Le prince de ce monde est condamné... Maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera expulsé."
Dans une lutte sans compromis contre l'église féodale et l'ensemble du système féodal, les bogomiles ont créé leur propre organisation suivant le modèle chrétien primitif. Leurs prédicateurs (« apôtres ») proclamaient inlassablement des idées rebelles : « Ils enseignent aux leurs à désobéir à leurs dirigeants », écrit un contemporain du mouvement Bogomil, « ils maudissent les riches, haïssent le roi, grondent les anciens, blâment les boyards, considèrent les serviteurs royaux sont vils pour Dieu et n'ordonnez pas à votre maître tous les travaux d'esclaves."
La doctrine Bogomil peu après son apparition s'est répandue dans d'autres pays. Aux X-XI siècles. sous son influence, des mouvements hérétiques ont surgi à Byzance, en Serbie, en Bosnie, à Kiev
Russie. Cette doctrine a eu un impact particulièrement fort sur l'idéologie des pays d'Europe occidentale, principalement le sud de la France et le nord de l'Italie, où les villes ont prospéré, la culture, l'artisanat et le commerce se sont développés. La prédication des "bonnes gens", cathares, patareni, albigeois (comme on appelait les hérétiques en Occident), fut un succès auprès des citadins, de certains groupes de la noblesse et des paysans ; vers la fin du XIIe siècle. l'Eglise catholique a perdu de son influence dans le sud de la France et le nord ! Italie. Les écrits secrets livrés en Italie depuis la Bulgarie décrivaient les problèmes de la cosmogonie et de l'univers, racontaient le dieu maléfique de l'Ancien Testament qui a créé le monde, et le Christ, appelé à sauver les gens du monde du mal, des ténèbres et de l'injustice. Pour discuter des problèmes de cosmogonie, les apôtres bogomiles de Bulgarie ("évêques hérétiques et pape", comme les appelaient les inquisiteurs) sont venus de Bulgarie à la cathédrale cathare du sud de la France (près de Toulouse).
Pour éradiquer l'hérésie, les papes organisent une série de croisades (guerres des Albigeois), instaurent l'Inquisition et les ordres mendiants (Dominicains et Franciscains). Simultanément à l'établissement de l'Inquisition, le pape Innocent III ordonna la destruction de tous les livres d'Écritures traduits en langue vernaculaire. Puis (1231) il fut interdit aux laïcs de lire la Bible.
De nouvelles vagues de mouvements hérétiques ont commencé dans la seconde moitié du XIVe siècle.
Mouvements hérétiques des XIV-XV siècles. reposaient sur les mêmes postulats idéologiques que ceux qui les ont précédés. Rejetant la tradition de l'Église comme une fabrication humaine, les hérétiques se référaient aux textes de la Sainte Écriture pour justifier leurs revendications. Extrêmement rare dans les hérésies des XIV-XV siècles. les idées de « deux dieux », caractéristiques des hérésies des Xe-XIIIe siècles, ont été reproduites, puisque les Albigeois et leur mémoire ont été complètement détruits par les croisades et l'Inquisition. Dans les hérésies les plus radicales du Moyen Âge classique et tardif, l'idée du «royaume du millénaire», le «Royaume de Dieu», proclamée dans la «Révélation de Jean» (Apocalypse), était largement répandue.
Sur la base des Saintes Écritures, certains hérétiques ont conclu que les richesses de l'Église contredisent les préceptes du Christ et des apôtres, que de nombreux rites et services religieux n'ont aucune justification dans le Nouveau Testament, que l'Église s'est écartée de la vraie foi et a besoin être substantiellement réformé. D'autres hérétiques ont attiré l'attention sur le fait que l'inégalité des classes, le servage, les privilèges nobles, les guerres, les exécutions, les serments et les tribunaux contredisent également la Sainte Écriture. Certains hérétiques se sont limités à la demande réforme de l'église et a souvent reçu le soutien des autorités laïques ; d'autres, sur la base de l'Ecriture Sainte, condamnaient le régime féodal et l'Etat en général.
Se concentrant sur l'alignement des forces de classe pendant la période de la guerre paysanne en Allemagne en 1525, F.
Engels a appelé le premier type d'hérésie bourgeois, le second - paysan-plébéien. Cette typologie contient les caractéristiques de classe sociale d'un certain nombre de mouvements hérétiques, mais de nombreuses sectes et mouvements importants à leur époque sont restés en dehors de celle-ci.
L'un des premiers représentants de l'hérésie de cette période était professeur à l'Université d'Oxford John Wycliffe parlant à la fin du XIVe siècle. contre la dépendance de l'Église d'Angleterre vis-à-vis de la curie papale et l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État. Wycliffe a condamné la hiérarchie de l'église et la richesse de l'église, arguant qu'elles étaient contraires aux Écritures.
Simultanément aux enseignements de Wycliffe, un mouvement est né en Angleterre Lollards, exigeant le transfert des terres aux communautés paysannes et l'abolition du servage. Leur enseignement a joué un rôle de premier plan dans la préparation du plus grand soulèvement paysan de Wat Tyler (1381), dont l'un des chefs était le prédicateur John Ball. Se référant aux Écritures, les Lollards ont condamné l'inégalité des classes. "D'où venaient leurs droits - disait John Ball à propos des nobles - s'ils n'étaient pas le fruit d'une usurpation ? Après tout, à l'époque où Adam labourait la terre et Eve filait, il n'était pas question des nobles." Les enseignements des Lollards étaient dirigés contre le système féodal dans son ensemble.
Peu de temps après la suppression du mouvement Lollard, la Réforme a commencé en République tchèque. La Réforme a commencé avec le discours Jean Hus contre les privilèges du clergé, les dîmes et les richesses de l'église. Après la perfide exécution de Hus (1415), une guerre nationale-bohémienne éclata contre la noblesse allemande et le pouvoir suprême de l'empereur allemand. Dans le mouvement hussite, deux courants furent bientôt déterminés - les Chashniki et les Taborites.
Programme chachnikov a été réduit à l'élimination des privilèges du clergé, la privation de l'église du pouvoir séculier, la sécularisation (transfert du pouvoir séculier) des richesses de l'église et la reconnaissance de l'indépendance de l'église tchèque.
Beaucoup plus radicales étaient les revendications Taborites, qui s'est opposé à l'Église catholique et à la hiérarchie ecclésiastique; en même temps, ils ont avancé un certain nombre de slogans anti-féodaux - la destruction des privilèges de la noblesse allemande et tchèque, l'élimination du servage et des devoirs féodaux, etc. Comme les premiers chrétiens, de nombreux taborites ont soutenu qu'un «royaume de mille ans» viendrait bientôt, dans lequel tout le monde serait égal et déciderait conjointement des affaires communes, il n'y aurait ni riches ni pauvres, ni propriété ni État.
La lutte contre les coupes et le manque d'unité dans leur propre environnement ont conduit à la défaite des Taborites ; mais leurs slogans furent bientôt utilisés lors de la Réforme en Allemagne.
Date de parution : 2014-11-02 ; Lire : 144 | Violation des droits d'auteur de la page
Chapitre 7
En plus des doctrines et enseignements officiels, un certain nombre d'idées politiques et juridiques très originales contiennent ce qu'on appelle. hérésies médiévales(de lat. heuresis - sélection, choix personnel) - enseignements hostiles au christianisme officiel et à l'église, créés par divers sectes(lat. sekta - façon de penser, d'enseigner). La raison de leur émergence et de leur propagation était l'exploitation et la violence, l'arbitraire et l'inégalité qui existaient dans le cadre du système féodal, ce qui a tout naturellement suscité la protestation des opprimés. Avec la prédominance de la religion dans la conscience publique et avec le soutien de l'église officielle « ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir », une telle contestation s'incarne naturellement sous la forme d'hérésies religieuses. Certains autres chercheurs non marxistes ont tendance à considérer les hérésies médiévales comme une forme de psychose de masse associée à l'attente de la fin du monde (G.Lebon), ou comme une manifestation du désir subconscient d'autodestruction des gens (I.Shafarevich ).
Les fondements religieux et philosophiques des hérésies médiévales étaient des enseignements tels que Gnosticisme et manichéisme. La doctrine du gnosticisme a été formée à la suite de la traduction d'anciens livres juifs (Ancien Testament) en langue grecque scientifiques d'Alexandrie au IIe siècle. ( Basilide, Valentin, Marcion). Du point de vue des gnostiques, la raison de l'existence du mal dans le monde dans le monde est la participation à sa création de deux dieux : le mal et le bien. Evil God - le créateur de l'Ancien Testament a créé le corps humain, le monde matériel mauvais et imparfait. Le bon Dieu, rédempteur du Nouveau Testament, a créé l'âme de l'homme et s'efforce de l'aider à se libérer des chaînes du monde matériel. Ainsi, le monde matériel tout entier est maudit et ce qu'il contient doit être détruit. Le fondateur de la doctrine manichéenne est un penseur persan Mani(lat. Manichéus), qui a vécu environ 216 à 270 ans. et descendant d'une famille royale. Selon les enseignements des Manichéens, dans le monde et dans l'âme humaine, il y a une lutte constante entre les principes brillants et bons, et le bien s'identifie à l'esprit, et le mal à la matière. Une personne, suivant l'exemple de Jésus, doit parvenir à la libération de son âme des forces obscures. Pour ce faire, une personne «dévouée» doit mener une vie ascétique (ne pas manger de viande, limiter les plaisirs sexuels et ne pas s'engager dans un travail physique ordinaire).
Quant à l'histoire, la montée des mouvements hérétiques tombe aux XIe-XIIe siècles, lorsque des groupes assez importants de personnes ont commencé à y participer. Les zones de plus grande distribution d'hérésies étaient le nord de l'Italie, le sud de la France, la Flandre et en partie l'Allemagne - c'est-à-dire lieux de développement urbain intensif. En même temps, si aux XIe - XIIIe siècles. le flux des mouvements hérétiques d'opposition n'est pas différencié selon les caractéristiques sociales et patrimoniales (il n'exprime pas les intérêts de groupes sociaux spécifiques), puis plus tard, aux XIVe-XVe siècles. les hérésies plébéiennes-paysannes et bourgeoises (urbaines) ont commencé à se démarquer clairement.
L'un des premiers mouvements hérétiques qui se sont répandus dans toute l'Europe a été Bogomilisme(Bulgarie, Xe - XIIIe siècles). Il exprimait le mécontentement des paysans bulgares réduits en esclavage, qui s'opposaient à l'exploitation de l'église féodale et à l'oppression nationale du pays par l'empire byzantin ; idéalisé les temps pré-byzantins et les rois bulgares jusqu'au 11ème siècle. Des opinions similaires à celles de Bogomil et générées par des conditions socio-économiques similaires dans Europe de l'Ouest aux XIe-XIIIe siècles. prêché Pataréna(du nom des ramasseurs de chiffons - le symbole des pauvres), Albigeois, Pauliciens(du nom du prédicateur Paul) Vaudois(une confrérie de mendiants du nom d'un marchand lyonnais, Pierre Wald), etc.
L'un des plus grands mouvements hérétiques a été cathares(purs), qui ont été subdivisés en dualiste et monarchique. dualiste croyait que la cause du mal terrestre est l'existence de deux dieux - le bien et le mal: le bon a créé l'âme humaine et le mal a créé la matière, la Terre et le corps humain. monarchique croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu bon, mais le monde matériel a été créé par son fils aîné (ange) qui s'est éloigné de Dieu - Lucifer ou Satan. Les deux directions reconnaissent que la matière, toutes les relations et institutions matérielles et sociales sont mauvaises. Par conséquent, la maternité et la famille, les autorités laïques et les lois, les tribunaux et les instruments de violence sont le produit du pouvoir obscur et doivent être détruits (en se cachant du monde, même les femmes enceintes ont été tuées). Ils concentrent leur propagande sur les couches urbaines inférieures, mais jouissent également d'une influence dans les couches supérieures (ils forment par exemple la suite du comte Raymond de Toulouse).
Les caractéristiques communes de toutes les hérésies ci-dessus étaient :
1) Critique acerbe de l'Église catholique romaine. Dans le même temps, sa structure hiérarchique et son magnifique ritualisme, sa richesse injustement acquise et ses membres du clergé embourbés dans le vice ont été sévèrement condamnés - une telle église, selon les adeptes des hérésies, a perverti le véritable enseignement du Christ, les principes mêmes de la philanthropie, de l'égalité et de la fraternité ;
2) Rejet du pouvoir étatique et de tous les ordres sociaux existants, des inégalités sociales, de la propriété et des lois (Vaudois : « les juges et les autorités ne peuvent pas condamner à mort sans commettre de péché ») ;
3) La demande d'abolir ou de détruire tout institutions sociales(pouvoir, famille, propriété), un appel aux croyants à revenir à l'organisation (communautaire) paléochrétienne de l'Église jusqu'à la communauté de propriété et d'épouses ; En particulier, sous l'influence de ces appels, les Cathares en France et en Italie ont détruit des églises et tué des évêques, les Taborites en République tchèque ont ouvertement appelé à la destruction autorités laïques et le clergé et la secte des Adamites, qui se distinguaient parmi eux, ont complètement détruit la population de la ville de Prchitsa (ils ont pris sur eux la mise en œuvre de la rétribution divine), et les Taborites à Gorodische ont introduit l'ordre dans l'esprit du communisme primitif .
4) S'appuyer sur des textes de la Bible interprétés indépendamment comme base idéologique de leurs mouvements ;
En conséquence, en 1129, le Concile de Toulouse interdit aux fidèles de posséder les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et surtout leurs traductions en langue vernaculaire. En 1231, la lecture et l'interprétation de la Bible par les laïcs sont interdites par la bulle du pape Grégoire IX.
L'église officielle n'était pas encline à minimiser le danger posé par les idées des hérétiques. Un chroniqueur médiéval a écrit à propos de l'hérésie des Albigeois (du nom de la ville d'Alba dans la province du Languedoc en France) : « L'illusion des Albigeois s'est tellement intensifiée qu'elle a bientôt infecté 1000 villes, et si elle n'avait pas été réprimée par l'épée du fidèle, il aurait bientôt infecté toute l'Europe.
Cependant, aux XIVe et XVe siècles. les hérésies bourgeoises plus modérées séparées des hérésies radicales paysannes-plébéiennes. Ils exprimaient les intérêts des couches aisées des citadins. Dans le cadre de nombreux enseignements de cette tendance, la nécessité de créer un État national plus fort a été justifiée, la demande d'une église bon marché a été avancée, ce qui, en fait, signifiait l'abolition de la classe sacerdotale, l'élimination de leurs privilèges et richesse, un retour à la structure simple de l'église chrétienne primitive. Dans le même temps, les adeptes des hérésies bourgeoises s'opposent à l'égalisation de la propriété et du statut social, estimant que la division de la société en domaines et l'institution de la propriété privée sont d'origine divine.
Les deux représentants les plus éminents de l'hérésie bourgeoise sont docteur en théologie et professeur à l'université d'Oxford en Angleterre. John Wycliffe(1324 - 1384) et théologien tchèque, chargé de cours à l'Université de Prague. Leader du mouvement anti-catholique et anti-allemand Jean Hus(1371 - 1415). En même temps, chacun d'eux forge sa propre doctrine politique, en fonction des spécificités de la situation de son pays et de son époque. J. Wycliffe, en particulier, a insisté sur l'indépendance de l'Église anglaise vis-à-vis de la Curie romaine, a contesté le principe de l'infaillibilité des papes et s'est opposé à l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État. Proche du roi Richard 2, il devient l'idéologue du mouvement pour la resubordination de l'Église au roi. Ses idées les plus radicales (sur la propriété en tant que produit du péché) n'ont pas été acceptées et, après sa mort, ses restes ont été confisqués et brûlés sur le bûcher.
Jan Hus était un adepte des idées de Wycliffe (ils sont venus en République tchèque par l'intermédiaire de l'épouse de Richard 2, un Tchèque de nationalité), et dans ses sermons, il a souligné la nécessité d'une lutte de libération nationale des larges couches du peuple. de la République tchèque contre les seigneurs féodaux allemands.
Mouvements hérétiques paysans-plébéiens des XIVe-XVe siècles.
ont été représentés dans l'histoire par des performances Lollards(prêtres mendiants inspirés par les idées de Wycliffe) en Angleterre et les Taborites (disciples de Huss) en République tchèque. Les Lollards, en particulier, réclamèrent le transfert des terres aux communautés paysannes et la libération des paysans de toute forme de dépendance féodale, participèrent activement à La rébellion de Wat Tyler(1381) - et ont été persécutés (acte de 1401 "Sur l'opportunité de brûler des hérétiques"). Le camp taborite s'est formé pendant la guerre nationale - paysanne tchèque (en alliance avec les classes inférieures de la ville et la petite noblesse locale) contre la noblesse allemande et le pouvoir de l'empereur allemand après la mort de Jan Hus lui-même - ils ont rassemblé des sectaires de tous sur l'Europe dans la colonie de Tabor. Dans l'esprit des idées radicales, ils réclamaient l'abolition non seulement de l'Église catholique romaine, mais aussi des institutions féodales elles-mêmes (privilèges de classe de la noblesse, toutes formes de devoirs féodaux), pour l'égalité universelle et la vie en communautés aux ordres égalitaires.
En conséquence, le mouvement Lollard et le mouvement taborite ont été vaincus par les efforts combinés du pouvoir royal, des seigneurs féodaux séculiers et spirituels. Ainsi, par exemple, pour combattre les Albigeois, le pape Innocent 3 fait appel aux seigneurs féodaux du Nord de la France et leur promet la propriété des hérétiques. Ils ont tué 15 000 personnes lors de la première bataille, puis ils ont tué tout le monde d'affilée. Le légat papal l'a motivé ainsi: "Tuez tout le monde, Dieu connaîtra les siens." Dans le même temps, les sectaires sont moins dangereux (par exemple, les vagabonds mendiants - les Vaudois ("Frères de Lyon") n'ont été soumis qu'à des persécutions administratives, et contrairement à eux, l'ordre mendiant des Franciscains a été créé (du nom du Catholique Saint François d'Assise).
Les idées radicales elles-mêmes ont trouvé leur écho dans les premières révolutions bourgeoises des XVIe et XVIIe siècles. (Allemagne, Hollande, Angleterre, par exemple, pelleteuses et niveleuses). Des hérésies bourgeoises plus modérées se sont également développées, dont certaines étaient incarnées dans l'idéologie de la Réforme bourgeoise de l'église du XVIe siècle.
Précédent9101112131415161718192021222324Suivant
VOIR PLUS:
Dans les conditions de la domination de la vision religieuse du monde et du rôle dirigeant de l'Église, tout désaccord avec l'ordre existant signifiait un discours contre "l'ordre de Dieu" et signifiait hérésie- faux enseignement, déviation de la religion officielle. Des hérésies sont apparues lorsque l'Église chrétienne est devenue une Église d'État, s'est retirée de sa simplicité originelle, de la démocratie et de la pauvreté, et la croissance de l'éducation et de la croissance économique à partir du XIIIe siècle, qui a ravivé l'intérêt pour le droit romain, a montré qu'il existe une justice plus juste que l'Église. Justice.
La formation des opinions hérétiques a été influencée Manichéisme- une religion née au IIIe siècle. en Iran sassanide et s'est propagé de la Chine à Rome. Dans son enseignement, Mani partait de l'idée dualiste de la lutte de la Lumière (bien) avec les Ténèbres (mal) : lors de sa rencontre avec les Ténèbres, la Lumière tombait dans les fers. Le monde qui est tombé au pouvoir des ténèbres n'a pas pu être sauvé. Il ne pouvait qu'être détruit. Ce n'est qu'alors que la Lumière sera libérée des chaînes.
Les affaires mondaines et terrestres sont au pouvoir du dieu des ténèbres.
Par conséquent, les personnes dans la vie terrestre ne peuvent pas être engagées dans les affaires du monde, avoir leur propre maison, famille, propriété, elles doivent observer la chasteté et l'abstinence afin d'atteindre la perfection et d'entrer dans le royaume de la Lumière après la mort. Mais l'ascèse est pour les élus (parfaits). Les classes inférieures sont les "écoutants" qui ont été autorisés à avoir leur propre maison, propriété, famille et vaquer à leurs occupations. Mais ils devaient nourrir, héberger les « parfaits » (les prêcheurs du manichéisme). Seulement avant la mort, pour que l'âme de "l'écoute" entre dans le royaume de la Lumière, il devait prendre l'initiation au "parfait".
En 282, l'empereur Dioclétien ordonna que "l'enseignement de ce persan" soit interdit dans l'Empire romain. Mais après la reconnaissance du christianisme comme religion dominante à Rome (IVe siècle), le manichéisme s'est largement répandu et ses adhérents se sont disputés avec l'église officielle.
Le christianisme, contrairement au manichéisme, procède de l'idée de l'intégrité du monde de Dieu. Bien que l'idée d'une lutte entre le bien et le mal, la présence du diable relève du même dualisme païen que le manichéisme.
Certains enseignements hérétiques provenaient du manichéisme, d'autres s'inspiraient de divers textes canonisés lorsqu'ils étaient en conflit avec la pratique de l'Église. Cela s'applique particulièrement à apocalypse- la partie la plus complexe du Nouveau Testament construite sur les allégories et le symbolisme
Dans divers enseignements hérétiques du début du Moyen Âge, cette idée a été réfractée de différentes manières. Par exemple, la Byzantine paulicien c'est une lutte entre le bien et le mal, qui était associée à la richesse et à l'exploitation qui lui était associée. Des Pauliciens cette idée passa aux Bogomilesà la Bulgarie. Contrairement aux manichéens, ils ont, comme les pauliciens, appelé les classes inférieures à désobéir à leurs maîtres. Aux XIIIe-XIVe siècles. les bogomiles se retirent de la lutte sociale et, dans le cadre des sectes urbaines, polémiquent avec l'église officielle. Les idées de ces enseignements ont formé la base Mouvement albigeois, né dans le sud de la France au XIIe siècle.
Les mouvements hérétiques les plus massifs se font en Europe avec le développement des villes. Selon les caractéristiques sociales, les hérésies médiévales étaient divisées en bourgeois et paysans-plébéiens. L'opposition bourgeoise à l'église officielle était modérée. Les citadins exigeaient généralement une église bon marché: l'élimination des privilèges coûteux du clergé, la simplification des rites religieux coûteux. Changer la structure sociale n'était pas pertinent pour eux, même si l'ordre féodal interférait avec les activités économiques des citadins. De plus, les bourgeois soutenaient généralement les nobles qui prônaient la sécularisation et la limitation de l'influence politique du clergé (par exemple, quilleurs en République tchèque).
Les hérésies paysannes-plébéiennes, qui réclamaient l'établissement de l'égalité sociale et, par conséquent, étaient dirigées contre l'ordre féodal, avaient une plus grande orientation sociale. L'idéal dans leurs enseignements était l'ordre communautaire. Par conséquent, au cœur de tous ces enseignements hérétiques se trouve la demande d'un retour à la simplicité, à l'ascétisme et à la démocratie des premiers chrétiens ( Pauliciens, les lollards En Angleterre, Taborites en République tchèque). Ils ont souligné que l'inégalité et l'exploitation contredisent les principaux dogmes chrétiens (sur l'égalité de tous devant Dieu, sur l'amour du prochain, etc.).
Il y avait de sérieuses différences dogmatiques entre les divers enseignements hérétiques. Mais tous étaient unis par une attitude fortement négative envers le clergé catholique, dirigé par le pape, en l'opposant aux premiers justes chrétiens, « évangéliques ». Presque tous les enseignements hérétiques procédaient du droit de chaque croyant de comprendre lui-même le christianisme sans l'aide du clergé, ils s'opposaient à l'inégalité entre les laïcs et le clergé en communion, et contre la vente des indulgences. La seule source de foi était Sainte Bible qui comprenait l'évangile. Sainteté et infaillibilité tradition sacrée- Les établissements des conseils d'église, les écrits des hiérarques d'église, les décrets et les bulles des papes - ont été rejetés.
Dès le XIIe siècle les hérésies, en tant que reflet du désir naissant de diversité spirituelle et de changement social, sont devenues un élément permanent de la vie européenne. C'était une protestation contre la volonté de l'Église officielle de préserver l'unanimité et l'inviolabilité de l'ordre socio-politique établi. La plus grande distribution aux XIIe-XIIIe siècles. des mouvements hérétiques ont atteint le sud de la France, en Provence, ce qui n'est pas un hasard. Ici, les enseignements des Cathares et des Vaudois se sont répandus.
Cathares(grec kataros - pur) étaient proches du bogomilisme (paulicisme) et des manichéens. Ils ont nié la divinité du Christ, le considérant comme un ange. L'essentiel pour eux est la lutte entre le bien et le mal, le monde spirituel avec le physique, créé par Satan, le diable.
Les premiers cathares étaient des missionnaires venus d'Orient, venus lors de la seconde croisade, entre 1140-1150. - les ascètes qui vivaient de l'aumône, en toute chasteté, condamnant le péché charnel en toutes circonstances. Contrairement à l'église officielle et à de nombreuses hérésies, les cathares reconnaissaient l'égalité des sexes, ce qui attirait chez eux un grand nombre de femmes. Le nombre de cathares comprenait non seulement des paysans et des classes inférieures urbaines, mais aussi des seigneurs féodaux mécontents de l'église officielle et de la politique de centralisation des rois de France, ainsi que des bourgeois. Mais si les Cathares avaient gagné, leur ascèse fanatique aurait conduit à la destruction des acquis de la culture matérielle. Ils étaient contre l'amélioration de la vie, qui conduisait, en fait, à la primitivité ; cela a contribué au déclin progressif de la secte. Le catharisme s'est répandu en Allemagne de l'Ouest, en Bourgogne, dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie, souvent en combinaison avec Vaudoisisme.
Fondateur de l'hérésie vaudoise Pierre(Pierre) Wald- prônaient également l'ascèse, l'opposant à la promiscuité du clergé officiel. Menant leurs sermons à l'extérieur de l'église, seuls, les Vaudois ont abandonné toute la structure et les rituels religieux officiels, ont rejeté les dîmes et les impôts, l'accomplissement des devoirs de l'État et de l'église. Ils étaient pour la restauration de la pureté évangélique, pour la soumission uniquement aux "bons" prêtres.
Dans le sud de la France, les Cathares et les Vaudois étaient souvent appelés Albigeois car M. Albi devint un des foyers de ces hérésies. Même si les différences entre les deux enseignements étaient importantes. Si les Vaudois procédaient de la reconnaissance du droit de prêcher en dehors de l'Église officielle (comme c'était le cas dans le christianisme primitif), s'opposaient au statut du clergé officiel, alors les Cathares étaient plus proches de l'image dualiste dans l'esprit des Manichéens, ils étaient également divisés en "parfaits" (ascètes) et "croyants", c'est-à-dire qu'ils allaient au-delà du christianisme.
Naturellement, les hérésies ont provoqué une vive rebuffade de la part de l'Église catholique.
L'un des moyens les plus efficaces de lutter pour le troupeau a été la création de soi-disant ordres monastiques mendiants qui a adopté l'une des principales exigences des hérétiques - la pauvreté comme forme de vie. C'étaient des commandes Dominicains et franciscains, surnommés militants pour le caractère actif et offensif de leurs activités. En quête de popularité, ils ont commencé à autoriser les sermons dans les langues maternelles de leurs ouailles.
L'ordre dominicain en 1216 a fondé un chanoine espagnol instruit (prêtre dans une grande cathédrale) Dominique de Guzman(1170-1221) pour combattre les hérésies dans le sud de la France. Fondateur de l'Ordre des Franciscains, fils d'un riche marchand italien François d'Assise(1181 / 82-1226) a agi, au contraire, presque comme un hérétique - avec la critique de la pratique de l'église et avec la prédication de la pauvreté. Les idées de pauvreté apostolique tombèrent rapidement en désuétude. Le besoin de propriété se révéla irrésistible et les ordres mendiants devinrent bientôt très riches. En général, l'idéal du Nouveau Testament avec l'égalité dans la communauté et la pauvreté apostolique s'accordait mal avec la vie réelle, avec la propriété de la propriété privée.
L'apogée de la lutte de la papauté contre les hérésies médiévales fut inquisition, introduite au XIe siècle. lors des guerres des Albigeois contre les hérétiques du sud de la France. Si l'ordre franciscain prêchait l'humilité et l'humilité, alors les dominicains visaient à l'origine à éradiquer les hérésies et s'appelaient eux-mêmes "chiens du Seigneur". En 1232, ils sont chargés de s'occuper des affaires inquisitoires. La peine la plus légère est un blâme et un avertissement. Mais généralement, les accusés étaient punis de prison et de confiscation des biens. Cela a été particulièrement bénéfique à la fois pour l'église et les rois en difficulté financière. Par conséquent, la volonté de condamner les riches est perceptible (un exemple frappant est la condamnation des Templiers en France au début du XIVe siècle).
En conséquence, l'église, dans la lutte contre la dissidence, a contribué au durcissement des lois laïques. Le manque de contrôle des tribunaux a corrompu l'église en tant qu'organisation. Le déni de culpabilité était déclaré persévérance dans l'hérésie et était passible de la peine de mort. Depuis que l'église déclara qu'elle abhorrait le sang, à partir de 1231 les hérétiques furent exécutés par le feu. Au total, 9 à 12 millions de malheureux ont été exécutés par l'Inquisition en Europe. Dès la fin du XVe siècle la plus active fut l'Inquisition en Espagne. L'incendie et l'expulsion d'environ 3 millions de personnes de ce pays ont contribué à son déclin économique au XVIe siècle. Seulement au XIXe siècle l'inquisition a perdu sa signification et s'est transformée en une "congrégation de l'office pontifical".
Date de parution : 2015-02-20 ; Lire : 1051 | Violation des droits d'auteur de la page
studopedia.org - Studopedia.Org - 2014-2018. (0.002 s) ...
Hérésies médiévales
V religion chrétienne, comme dans d'autres religions monothéistes, il y avait de nombreux enseignements hérétiques (en désaccord avec le dogme officiel). Ils ont commencé à apparaître à partir du moment où le christianisme est devenu la religion d'État officiellement reconnue et l'ont accompagné tout au long de l'histoire. L'émergence des hérésies s'explique par le fait que le christianisme médiéval exprimait la conscience religieuse de divers groupes sociaux, à la fois les élites féodales et les larges masses populaires. Par conséquent, toute insatisfaction à l'égard du système féodal était inévitablement revêtue de la forme d'hérésie théologique. "Pour pouvoir s'attaquer aux relations sociales existantes, il fallait leur arracher l'auréole de la sainteté."
Le développement de mouvements hérétiques de masse en Europe occidentale a été associé à l'émergence et à l'épanouissement des villes. Les contrastes sociaux prononcés entre citadins et seigneurs féodaux, entre les différentes couches de propriété de la population urbaine, la vie politique active et l'organisation des citadins ont créé des conditions favorables à l'émergence d'enseignements hérétiques. Ces enseignements, de caractère différent, exprimaient la protestation des masses urbaines et paysannes contre le système féodal en place. "L'opposition révolutionnaire au féodalisme ... apparaît, selon les conditions de l'époque, tantôt sous la forme de mysticisme, tantôt sous la forme d'une hérésie ouverte, tantôt sous la forme d'un soulèvement armé."
De par leur nature, les hérésies médiévales étaient divisées en bourgeois et paysans-plébéiens.
Les hérésies bourgeoises exprimaient la protestation des petits propriétaires citadins contre l'ordre féodal, et surtout contre les institutions ecclésiastiques qui entravaient le développement des villes et leur économie. Ils ont exigé l'élimination des privilèges du clergé et la privation de leurs biens matériels, la sécularisation des biens de l'église, la simplification et la dévalorisation des rites ecclésiastiques. Leur idéal était « l'église apostolique » des premiers chrétiens. C'étaient des hérésies modérées qui ne niaient pas en principe le système féodal existant. Par conséquent, les idées de l'hérésie bourgeoise trouvaient souvent un soutien parmi certains groupes de seigneurs féodaux intéressés par la sécularisation des biens de l'Église et limitant l'influence du clergé et de la curie papale.
Le mouvement hérétique paysan-plébéien est allé beaucoup plus loin, exprimant les aspirations des couches inférieures du peuple et exigeant l'instauration de l'égalité entre les peuples. Les hérésies égalitaires les plus radicales représentaient l'idéologie des masses qui luttaient par les armes contre l'oppression féodale (les « Frères apostoliques », les Lollards, les Taborites). Les premiers mouvements hérétiques combinaient souvent des éléments des deux directions (albigeois).
Entre les enseignements hérétiques individuels, il y avait des différences dogmatiques significatives. Néanmoins, tous étaient unis par une attitude fortement négative envers le clergé catholique, dirigé par le pape, et l'opposition à lui des pasteurs bibliques. Des attaques particulièrement vives ont été causées par la vente des indulgences et l'inégalité dans la communion. Les hérétiques ont appelé l'Église "la putain de Babylone" et le pape - "le vicaire de Satan". Contrairement à l'église hiérarchique, ils ont créé leur propre organisation religieuse simple et ont introduit des rites simplifiés. Les hérétiques reconnaissaient l'Evangile comme la seule source de la foi et rejetaient complètement la "tradition sacrée" (les écrits des Pères de l'Eglise, les décrets des conciles, les bulles papales). L'idée de "pauvreté apostolique" était très populaire, ce qui, chez certains hérétiques, s'est transformé en ascèse stricte. Les idées mystiques basées sur une interprétation particulière des prophéties bibliques, en particulier les visions de l'Apocalypse, étaient largement répandues. Les hérésiarques Joachim Florsky, Dolcino ont prédit un coup d'État inévitable, qui devrait avoir lieu dans un proche avenir. Les idées de cette révolution et l'établissement du « royaume millénaire de Dieu » sur terre (chiliasme, millénarisme) étaient très populaires parmi les masses paysannes-plébéiennes. Une autre tendance bourgeoise modérée dans le mysticisme affirmait que la «vérité divine» est contenue dans l'homme lui-même, et niait ainsi la nécessité de l'église. Il contenait des éléments de panthéisme. Mais cet individualisme mystique conduit loin de la lutte active, dans le monde intérieur de l'homme, éveillant des «visions» et l'extase religieuse.
Les enseignements hérétiques sapaient l'autorité de l'Église, portaient un coup au dogme catholique et contribuaient à la diffusion de la libre pensée. Néanmoins, les hérétiques eux-mêmes restaient fanatiques de leurs croyances et, comme les catholiques, étaient hostiles à l'hétérodoxie et à la dissidence. De plus, toutes les sectes modérées ont limité leur prédication aux seules exigences des réformes de l'Église, le remplacement de la « mauvaise église » et de la « fausse foi » par la « bonne église » et la « vraie foi », détournant les masses de la lutte active contre oppression féodale.
Tout d'abord, les mouvements hérétiques se sont répandus dans les villes d'Italie, où les antagonismes sociaux étaient particulièrement prononcés. Dans la seconde moitié du XIe siècle. Pataria est apparue à Milan et dans d'autres villes lombardes (du nom du quartier de Milan, où vivaient les mendiants et les travailleurs de pacotille).
Les Patarans fustigeaient la dépravation des mœurs du clergé, réclamant un célibat strict et le renoncement des « serviteurs de Dieu » aux biens matériels. Cependant, ils s'opposent à la noblesse féodale et aux riches marchands. Mais les Patarans n'ont pas encore créé un enseignement développé de manière cohérente. Une autre secte, fondée par Arnold de Brescia (Arnoldistes), proposa un programme radical de transformation politique - privant le clergé du pouvoir politique et créant (en particulier à Rome) un gouvernement républicain purement laïc. C'était la première hérésie bourgeoise.
Le mouvement hérétique atteint son apogée dans la seconde moitié des XIIe-XIIIe siècles. Son centre était le sud de la France, caractérisé à cette époque par un haut niveau de développement économique et culturel. Deux enseignements hérétiques se sont répandus ici - le catharisme et le vaudois. Le catharisme ("kataros" - grec "pur") appartenait aux hérésies dualistes et était associé au bogomilisme qui s'est répandu en Bulgarie. Il soutenait que dans le monde il y a une lutte éternelle entre le bien et le mal, et que le bien doit triompher du mal. Sous le bien, les Cathares comprenaient le principe spirituel, sous le mal - le monde physique créé par Satan. Ils considéraient également que l'église existante, dirigée par le pape, était mauvaise. Les Cathares ne reconnaissaient que l'Evangile, rejetant complètement l'Ancien Testament. Ils ont créé leur propre église, simple, sans hiérarchie de rangs spirituels. Les autres croyants étaient divisés en deux catégories - "parfaits" et "croyants". Les premiers menaient une vie ascétique et remplissaient les fonctions de bergers, les seconds étaient de simples laïcs, suivant avec zèle les préceptes de leur foi. Le catharisme s'est répandu dans les pays du sud de l'Europe, souvent en combinaison avec d'autres hérésies, comme le vaudois.
L'hérésie vaudoise est apparue à la fin du XIIe siècle. dans le sud de la France. Son fondateur était Peter Wald, fils d'un riche marchand lyonnais. Renonçant à sa richesse, il se mit à prêcher une vie mendiante et l'ascèse. Les Vaudois rejetaient la plupart des sacrements chrétiens, les prières, les icônes, le culte des saints, la doctrine du sanctuaire et ne reconnaissaient pas la hiérarchie ecclésiale. Ils prêchaient « la pauvre église apostolique ». Les hérétiques refusaient de payer impôts et dîmes, d'accomplir le service militaire, ne reconnaissaient pas la cour féodale, s'opposaient peine de mort. Les Vaudois partageaient certaines vues communes avec les Cathares. Dans le sud de la France, tous deux étaient appelés Albigeois (du nom de la ville d'Albi). Au XIIIe siècle. une partie des Vaudois modérés se rapprochent de l'Église catholique et jouissent du droit de prêcher leurs opinions (« pauvres catholiques »). Une autre partie des Vaudois s'est déplacée vers l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, où cette hérésie a existé jusqu'à la fin du Moyen Âge. Les Vaudois extrêmes ont fusionné avec les Cathares.
Aux XIVe-XVe siècles. les hérésies radicales paysannes-plébéiennes devinrent l'idéologie des soulèvements révolutionnaires. La secte des apostoliques organisa un soulèvement dirigé par Dolcino. Le premier mouvement Lollard (en la personne de John Ball) a joué un grand rôle dans la rébellion de W. Tyler. Les Taborites constituaient un front extrêmement révolutionnaire du mouvement hussite et des guerres hussites. Les hérésiarques bourgeois en la personne de J. Wyclef et J. Hus ont créé la base théorique des premiers mouvements de réforme.
Lutte de l'Église contre les hérésies. Inquisition, ordres mendiants
Les idées hérétiques rencontrèrent une rebuffade féroce de la part de l'Église catholique. cathédrales d'église anathématise les hérésiarques et leurs partisans. Pour réprimer les mouvements hérétiques de masse, l'église organisa des croisades (guerres des Albigeois, campagnes contre les apostoliques, cinq croisades contre les hussites). A la fin du XIIème siècle. l'Inquisition est apparue (lat. inquisitio - enquête) pour le procès et les représailles des hérétiques. Au début, l'Inquisition était subordonnée aux évêques. Au XIIIe siècle. il devint une institution indépendante sous l'autorité suprême du pape. Un système d'enquête judiciaire a été mis en place, utilisant des tortures sophistiquées, des sophismes complexes et des intimidations, à l'aide desquels des aveux de culpabilité ont été extorqués aux victimes. L'espionnage et les dénonciations ont été largement utilisés, encouragés par le transfert d'une partie des biens des condamnés à des informateurs. Pour punition, les condamnés ont été remis aux autorités laïques, car l'église a hypocritement refusé de "verser le sang". Habituellement, les hérétiques condamnés étaient brûlés sur le bûcher. Dans le même temps, des cérémonies solennelles étaient souvent organisées pour prononcer le verdict de l'Inquisition sur un groupe d'hérétiques - auto-da-fe (espagnol pour "acte de foi"). Les pécheurs repentis étaient condamnés à la réclusion à perpétuité. Les scientifiques soupçonnés de libre-pensée et en désaccord avec les canons établis par l'Église catholique tombaient sous la tutelle de l'Inquisition.
Les activités de l'Inquisition représentent l'une des pages les plus sombres du Moyen Âge.
L'Inquisition seule ne pouvait pas faire face aux mouvements hérétiques de masse. L'Église a essayé de saper ces mouvements de l'intérieur, de prouver les "illusions" des hérétiques qui s'étaient égarés de la "vraie foi". A cette fin, l'Eglise reconnut certaines sectes modérées et les transforma en ordres mendiants. Ainsi en était-il des franciscains.
Le fondateur de cet ordre, François d'Assise (1182-1226), est issu d'une famille italienne riche et distinguée. A l'instar de Peter Wald, il alla mendier, prêchant l'ascèse et le repentir. François n'a pas nié l'église et le monachisme en principe, mais a seulement appelé le clergé à suivre «l'exemple apostolique» - errer et prêcher parmi le peuple, gagner sa vie par le travail et par l'aumône. C'était ce mode de vie que menaient ses partisans - les "petits frères" (minorités). Le Pape légalisa les activités de prédication de François et de ses disciples et approuva en 1210 l'Ordre des Franciscains. L'Église a même déclaré François saint. Les franciscains abandonnèrent bientôt leurs revendications d'"égalité" et de "pauvreté" et devinrent un peuple très riche et influent. ordre monastique. Leur objectif principal était de lutter contre la propagation des enseignements hérétiques. Les moines ont pénétré la masse des hérétiques et par leurs sermons et leur exemple ont tenté de les distraire des "erreurs" de l'hérésie et de les renvoyer dans le giron de l'Église catholique. L'ordre avait une organisation centralisée stricte dirigée par un "général" relevant directement du pape.
A l'instar de l'ordre franciscain, en 1216 fut créé l'ordre dominicain, dont le créateur fut le moine fanatique espagnol Dominique. Les membres de cet ordre mendiant menaient un mode de vie différent de celui des franciscains. Ils ne s'habillaient pas de haillons, mais de robes d'érudits. Ce sont des "frères-prédicateurs" instruits qui prennent en charge le système éducatif, et surtout les départements théologiques des universités. Du milieu d'eux sont sortis des piliers célèbres de la scolastique et de la théologie comme Albert le Grand et Thomas d'Aquin. L'objectif principal des dominicains était la lutte contre les hérésies. Se faisant appeler "chiens du Seigneur" (domini cannes - en accord avec "Dominicains"), ils ont écrasé les hérétiques non seulement dans les départements des universités, mais aussi avec les armes de l'Inquisition. Parmi ceux-ci, les tribunaux de l'Inquisition étaient généralement achevés.
Les ordres mendiants étaient également engagés dans des activités missionnaires, fondant leurs monastères dans des pays non catholiques. Les dominicains ont pénétré comme prédicateurs et diplomates dans les pays de l'Est - la Chine et le Japon.
La chute de la papauté au XIVe siècle Mouvement cathédrale
Au début du XIVe siècle. situation politique en Europe occidentale a radicalement changé. Le processus de centralisation de l'État a beaucoup avancé. Des États-nations ont commencé à se former. Le pouvoir royal subordonnait à sa domination la noblesse féodale - laïque et ecclésiastique. Le clergé était privé de privilèges - exonération d'impôts et droit de juridiction ecclésiastique spéciale. La question s'est posée de créer une église nationale indépendante de la curie romaine. La théocratie papale touchait à sa fin.
Mais la papauté, contrairement à ces nouvelles tendances, a tenté de défendre et même de renforcer ses prétentions théocratiques, niant par principe l'idée d'une souveraineté étatique laïque. C'est sur cette base qu'une lutte acharnée s'est déroulée entre le roi de France Philippe IV et le pape Boniface VIII, qui s'est soldée par la victoire du roi. La résidence papale a été déplacée vers la ville française d'Avignon, et pendant 70 ans (1309-1378) la papauté était en « captivité », suivant l'exemple des rois français.
Avec le retour du trône papal à Rome, le «grand schisme» (schisme) a commencé, lorsque deux ou même trois papes étaient sur le trône en même temps. Au cours de cette lutte, accompagnée de malédictions et d'anathèmes mutuels, la papauté a perdu son ancien prestige, la hiérarchie catholique a été plongée dans une crise prolongée. À cette époque, un mouvement conciliaire se développe au sein de l'Église catholique, poursuivant l'objectif de limiter l'autocratie papale et d'assujettir le pape. concile œcuménique. Le mouvement conciliaire a trouvé un soutien actif des monarchies d'Europe occidentale, qui ont cherché à se libérer de l'ingérence papale et à établir la suprématie laïque de l'État. Le roi de France Charles VII, sur la base de décrets conciliaires, édicte en 1438 une « Sanction pragmatique » proclamant les principes de « l'Église gallicane » et la suprématie des cathédrales en matière de foi. Le droit de nomination aux postes ecclésiastiques a été reconnu au roi et la compétence du clergé devant les tribunaux d'État a été établie. Des mesures similaires ont été prises dans d'autres pays, par exemple en Angleterre et dans certaines principautés allemandes.
L'une des principales tâches du mouvement conciliaire et sa raison d'être était le désir de la hiérarchie catholique de surmonter le schisme et de renforcer l'autorité de l'Église. Le concile de Pise en 1409 a supprimé les papes d'Avignon et de Rome et a élu un nouveau pape, Alexandre V. Cependant, cela n'a pas éliminé le schisme. Au lieu de deux, il y a maintenant trois papes.
Au concile de Constance suivant (1414-1418), outre l'élimination du schisme, les questions d'une réforme générale de l'Église et de la lutte contre « l'hérésie hussite » furent discutées. Mais le concile n'a résolu aucun de ces problèmes sur le fond. Jan Hus a été condamné par la cathédrale et brûlé sur le bûcher. Cependant, en République tchèque, un mouvement populaire a surgi contre l'Église catholique et la domination allemande, qui a finalement gagné. Un décret est adopté sur la suprématie de la cathédrale sur le pape. Jean XXIII est déposé. Il s'est avéré que dans le passé ce grand prêtre (Baltazaro Cossa) était un pirate et un faussaire. La cathédrale a élu pape Martin V. Mais la scission a continué, puisque l'un des papes précédents - Benoît XIII - n'a pas renoncé à sa dignité. En 1431, un concile fut convoqué à Bâle, qui dura par intermittence jusqu'en 1449. Son succès fut la conclusion d'un accord de compromis avec les hussites modérés.
Le pape Eugène IV ne s'est pas soumis au concile de Bâle et a convoqué son propre concile spécial à Ferrare. En 1439, cette cathédrale fut transférée à Florence, où une union fut conclue entre les églises catholique et orthodoxe. L'empereur byzantin et le patriarche de Constantinople espéraient recevoir une aide militaire de l'Occident contre les Turcs et faisaient de grandes concessions au catholicisme et au pape. Mais la population et une partie importante du clergé rejettent l'union. Il n'a ensuite été possible de le tenir que dans les régions occidentales de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui étaient sous la domination de la Lituanie et de la Pologne.
Le schisme se poursuit et ce n'est qu'à l'assemblée de la cathédrale de Lausanne (1449) qu'un accord est conclu sur la restauration de l'unité : le dernier antipape Félix V renonce à ses prétentions au trône et Nicolas V reste le seul chef de l'église.
La liquidation du "grand schisme" n'a pas conduit à la restauration de l'ancien pouvoir de la Curie romaine. Le pape a de plus en plus perdu le rôle de chef universel de l'Église catholique et est devenu l'un des princes ordinaires de l'Italie centrale. Mais la papauté a continué à être la force organisatrice de la réaction catholique. La curie romaine a dirigé l'Inquisition, qui a brutalement réprimé les mouvements anti-catholiques progressistes. La papauté a joué un rôle non moins réactionnaire dans le destin historique de l'Italie. Possédant le centre du pays, il s'oppose à son unification nationale et politique.
compétence ecclésiastique. Inquisition
L'un des privilèges les plus importants de l'Église était le droit à sa propre juridiction, à son propre tribunal. Les personnes appartenant à l'église, qu'elles soient moines ou paysans qui travaillaient sur les terres monastiques, devaient intenter des poursuites devant les tribunaux ecclésiastiques (à quelques exceptions près) non seulement pour des litiges civils, mais aussi pour des infractions pénales.
Le début d'une juridiction ecclésiastique spéciale remonte à l'époque romaine. En dehors de la loi, les communautés chrétiennes devaient résoudre elles-mêmes les différends qui s'élevaient entre elles, sans recourir ni à la loi des païens détestés ni à leurs juges méprisés. Cette pratique a ensuite été confirmée dans « l'épître » attribuée à l'apôtre Paul : elle interdit de soumettre les litiges litigieux au règlement des « infidèles ».
Sur la base d'une disposition très vague selon laquelle tous les crimes liés au péché sont soumis au tribunal de l'Église, celle-ci s'est approprié la compétence pour des crimes tels que l'hérésie, l'apostasie, la sorcellerie, le sacrilège (vol de biens de l'Église, ainsi que la violence contre un prêtre), violation de fidélité, inceste, bigamie, parjure, calomnie, faux, faux serment, usure.
Comme les contrats étaient très souvent scellés par des serments religieux, l'Église a déclaré que le domaine des obligations était sa compétence, insistant sur le fait que toute obligation, même si elle était contraire à la loi, devait être remplie pour le salut de l'âme de l'entreprise.
Dans le domaine du mariage et des relations familiales, l'Église chrétienne s'est arrogé le droit de contrôler la répartition des biens entre les héritiers légaux et l'exécution des testaments. De tout cela, l'Église a appris à tirer des bénéfices considérables. Elle a repris les fonctions de police et a surveillé de près la vie de son troupeau. Quiconque osait critiquer l'Église ou ses ministres, même les plus petits, était menacé d'excommunication.
Si l'excommunié ne se repentait pas, la "sainte inquisition" envoyait le chercher, un tribunal spécial créé pour traiter les "hérétiques" - apostats et dissidents. En 1232, le pape ordonna que tous les cas d'hérésie soient traités par l'ordre des frères dominicains. En 1252, l'Inquisition a été autorisée à recourir à la torture. Indépendante de toutes les autorités locales, ne reconnaissant d'autre loi que la sienne, l'Inquisition devient une force redoutable.
Avec l'apparition d'un inquisiteur dans une ville particulière, les habitants reçurent l'ordre de venir dénoncer les personnes qu'ils soupçonnaient d'apostasie. Quiconque échappait à la dénonciation était déclaré excommunié de l'église. L'Inquisition pourrait déclencher des persécutions et des rumeurs.
Dans le procès inquisitoire, la même personne a mené l'enquête préliminaire et rendu le verdict. Ainsi, au lieu de vérifier les preuves et de les évaluer, le tribunal n'a fait que confirmer l'opinion déjà établie.
Ne répondant que de douceur, mais pas de cruauté, l'enquêteur n'a ménagé aucun effort pour obtenir des aveux de l'accusé. Plus la question était délicate, plus tôt elle pouvait confondre l'interrogé, mieux elle était considérée.
Le jugement était, en règle générale, secret, accompagné d'un rituel sombre et terrifiant.
S'il n'était pas possible d'obtenir des aveux rapides, l'enquête prenait fin et ils recouraient à la torture. L'Inquisiteur n'était pas lié par sa méthode ou son temps. Il commençait la torture à n'importe quelle étape du processus et y mettait fin lorsqu'il estimait que c'était nécessaire, ou lorsqu'il avait obtenu des aveux, ou lorsque sa victime mourut, incapable de supporter le supplice. En même temps, le protocole de torture indiquait certainement que si la personne torturée « brise un organe » ou meurt, elle-même sera à blâmer.
Les inquisiteurs ont-ils compris que la torture pouvait produire de faux aveux forcés ? Sans aucun doute. Mais ils avaient besoin de créer une atmosphère d'horreur générale, leur permettant de dominer sans limite. L'un des plus cruels persécuteurs de l'esprit, Konrad de Marbourg (XIIIe siècle), croyait qu'il valait mieux tuer 60 innocents que de laisser échapper un coupable. Cet inquisiteur a envoyé des centaines de personnes à la mort sur simple suspicion. La torture corrompait les juges eux-mêmes : la cruauté devenait une habitude.
La reconnaissance a été suivie par la soi-disant réconciliation avec l'église, qui consistait en la rémission des péchés. L'accusé devait confirmer le procès-verbal de l'interrogatoire, indiquant sans faute que les aveux qu'il avait faits étaient volontaires et non forcés (après torture).
S'il refusait de le faire, ainsi que si les témoignages donnés au cours de l'enquête changeaient, l'accusé était à nouveau (et cette fois complètement) "déchu" de l'église, pour laquelle il était déjà inconditionnellement brûlé vif.
La confession a permis d'éviter de brûler sur le bûcher, mais vouée à la réclusion à perpétuité. Le déni de culpabilité a conduit à l'incendie. En même temps, on croyait que l'église "ne verse pas le sang". Un acquittement était rare, mais même dans ce cas, une personne était répertoriée comme suspecte et sa vie a été entourée de difficultés jusqu'à sa mort. Un nouveau soupçon - et rien ne pouvait le sauver de la prison ou d'une mort douloureuse.
Parmi les procès politiques qui ont pris une carapace religieuse, le procès de Jeanne d'Arc, une fille du peuple, l'héroïne de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre (XVe siècle), brûlée sur le bûcher par la décision du clergé français corrompu, se distingue particulièrement.