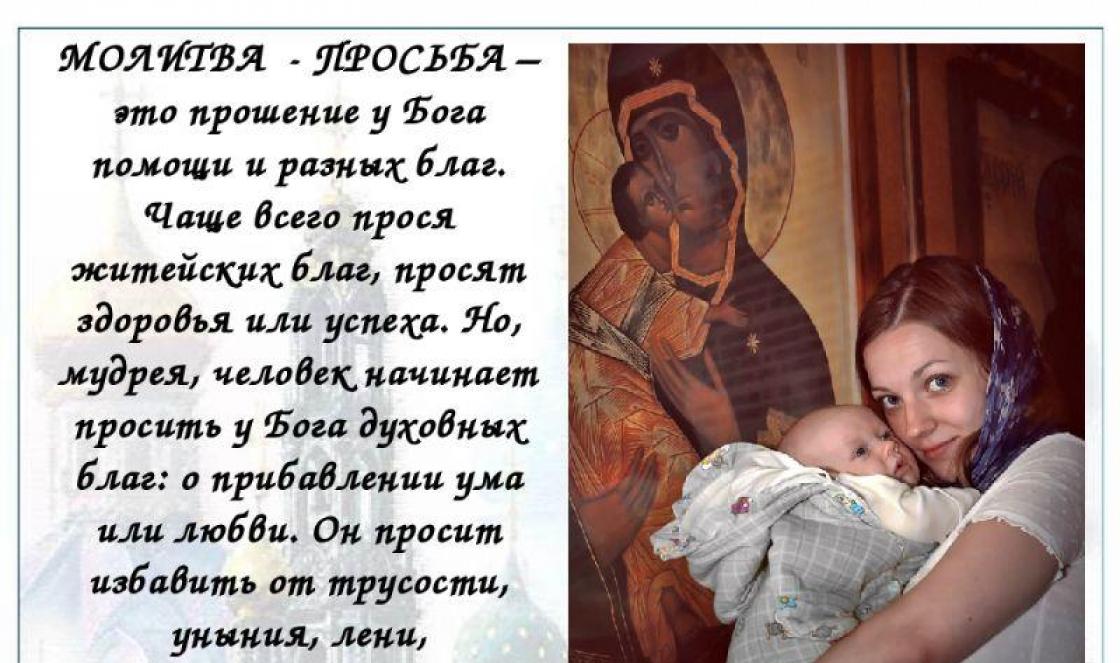Examinons quelques valeurs éthiques fondamentales.
Plaisir. Parmi les valeurs positives, le plaisir et le bénéfice sont considérés comme les plus évidents. Ces valeurs correspondent directement aux intérêts et aux besoins d'une personne dans sa vie. Une personne qui, par nature, aspire au plaisir ou à l'utilité semble se manifester d'une manière tout à fait terrestre.
Plaisir (ou jouissance)- c'est un sentiment et une expérience qui accompagnent la satisfaction des besoins ou des intérêts d'une personne.
Le rôle des plaisirs et des peines est déterminé d'un point de vue biologique, par le fait qu'ils remplissent une fonction d'adaptation : l'activité humaine dépend du plaisir, qui répond aux besoins du corps ; le manque de plaisir, la souffrance entravent les actions d'une personne, sont dangereux pour elle.
En ce sens, le plaisir, bien sûr, joue un rôle positif, il est très précieux. L'état de satisfaction est idéal pour le corps et une personne doit tout faire pour atteindre un tel état.
En éthique, ce concept est appelé hédonisme (du grec. fini - "plaisir"). Cette doctrine est basée sur l'idée que la recherche du plaisir et la négation de la souffrance est le sens principal des actions humaines, la base du bonheur humain.
Dans le langage de l'éthique normative, l'idée principale de cet état d'esprit s'exprime ainsi : « Le plaisir est le but vie humaine Tout est bon,
qui donne du plaisir et y conduit. Freud a apporté une grande contribution à l'étude du rôle du plaisir dans la vie humaine. Le scientifique a conclu que le "principe de plaisir" est le principal régulateur naturel des processus mentaux, l'activité mentale. Le psychisme, selon Freud, est tel que, quelles que soient les attitudes d'une personne, les sentiments de plaisir et de déplaisir sont décisifs. Les plus frappants, ainsi que relativement accessibles, peuvent être considérés comme les plaisirs corporels, sexuels et les plaisirs associés à la satisfaction des besoins de chaleur, de nourriture et de repos. Le principe de plaisir s'oppose aux normes sociales de décence et fonde l'indépendance personnelle.
C'est dans le plaisir qu'une personne est capable de se sentir, de se libérer des circonstances extérieures, des obligations, des attachements habituels. Ainsi, les plaisirs sont pour une personne une manifestation de la volonté individuelle. Derrière le plaisir, il y a toujours le désir, qui doit être réprimé par les institutions sociales. Le désir de plaisir s'avère être réalisé en s'écartant des relations responsables avec les autres.
Un comportement ordinaire basé sur la prudence et l'acquisition de bénéfices est à l'opposé d'une orientation vers le plaisir. Les hédonistes distinguaient les aspects psychologiques et moraux, la base psychologique et le contenu éthique. D'un point de vue moral et philosophique, l'hédonisme est l'éthique du plaisir.
Aujourd'hui, presque tous les membres de la race humaine veulent trois choses :
- plaisir;
- jeunesse éternelle (santé);
- joie.
De plus, le plaisir et le bonheur se confondent dans la plupart des cas en un seul phénomène. Les gens croient qu'après avoir atteint le plaisir, ils atteindront le point culminant de l'existence humaine - le bonheur.
Qu'est-ce que l'hédonisme
L'hédonisme est un système de valeurs qui voit le but le plus élevé de l'existence humaine dans le plaisir. Pour un hédoniste, plaisir et bonheur sont synonymes. Et ici, peu importe ce dont une personne tire le plus grand plaisir: des plaisirs sensuels (sexuels, gastronomiques) ou intellectuels et spirituels (lire des livres, regarder des films). Les efforts intellectuels et les plaisirs sensuels sont mis sur un pied d'égalité lorsque les premiers ne poursuivent pas le but d'apprendre, mais sont accomplis uniquement pour le plaisir. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'hédonisme est, entre autres, une activité qui n'est pas grevée par un objectif et des résultats externes ou internes. Par exemple, une personne regarde des films et lit des livres uniquement pour le divertissement ou l'estime de soi.
L'hédonisme est profondément enraciné dans la nature humaine

Probablement le psychologue le plus connu du XXe siècle, Z. Freud, a fondé son enseignement (la psychanalyse) sur le principe de l'hédonisme (le plaisir). Selon le médecin autrichien, l'homme est un hédoniste naturel. Dans la petite enfance, ses besoins sont satisfaits directement et rapidement : soif, faim, besoin de soins maternels. Lorsqu'une personne grandit, la société lui impose des exigences et insiste pour qu'elle garde le contrôle, limite son désir de plaisir et satisfasse ses besoins au bon moment. En termes psychanalytiques, la société veut que le "principe de réalité" obéisse au "principe de plaisir".
Ainsi, la société contrôle en quelque sorte une personne par la «méthode symbolique»: apprenez, travaillez dur - profitez-en. En même temps, il est clair que la vie ne peut consister en un plaisir continu, car une telle forme d'existence, bien qu'elle soit possible pour certains (par exemple, les enfants de parents très riches), conduit à la décadence morale et, par conséquent , à la dégradation sociale.
Alcooliques et toxicomanes victimes de la poursuite irréfléchie du plaisir

Il existe une expérience très célèbre : une électrode était attachée au centre du plaisir dans le cerveau d'un rat, et le fil qui en sortait était attaché à une pédale et fait en sorte qu'à chaque fois que le rat appuyait sur la pédale, une décharge électrique stimulait le centre de plaisir. Au bout d'un moment, le rat refusa l'eau et la nourriture et n'appuya que sur la pédale, savourant constamment, se noyant dans une douce langueur, mais le plaisir la tua peu à peu. C'est pourquoi l'hédonisme est un système de valeurs qui a besoin d'une limite morale.
Cela peut sembler cruel et cynique, mais les alcooliques et les toxicomanes sont les mêmes "rats" qui ont oublié le monde pour le plaisir. Alcool pour une bouteille. Accro à la drogue. Le truc avec les addictions, c'est qu'elles vous procurent une sensation rapide de bonheur. Mais en général, dans la vie, un moment de bonheur se mérite. Par exemple, une personne travaille et travaille, et lorsque le travail est terminé, elle éprouve une « piqûre » soudaine (peut-être attendue) de bonheur. Mais au bout d'un moment, il faut retravailler. Qui acceptera cela ?
Les stimulants, quant à eux, procurent une sensation de bonheur sans limites avec presque aucun effort par rapport au travail réel, incarnant en fait le postulat de base de l'existence humaine, sur lequel insiste l'éthique de l'hédonisme dans son expression vulgaire : il faut vivre dans une telle manière à ce que la vie donne le plus de plaisir possible. Et si possible, le plaisir doit être aussi intense que possible.
La nourriture et le sexe comme pièges pour les connaisseurs de plaisirs sensuels

Mais non seulement les amateurs d'expériences avec leur conscience sont en danger. Gloutons et voluptueux ne doivent pas non plus se relâcher. Certes, les premiers perdent leur apparence humaine et ne se détruisent qu'eux-mêmes, mais les seconds peuvent bien nuire aux autres.
Film "Basic Instinct". Cas de Katherine Tramell
Il n'y aura pas de description détaillée de l'intrigue du film ici, car elle n'est pas incluse dans les tâches, mais il faut dire que Catherine Tramell est un cas classique d'hédoniste qui a franchi les lignes du bien et du mal. Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'elle s'ennuyait avec le sexe régulier et s'est tournée vers le sexe qui impliquait de tuer pour le plaisir. Si le plaisir ne poursuit aucun but moral, alors il devient vite ennuyeux. Une personne passe d'un plaisir à un autre, ne trouvant de repos nulle part (la description classique d'un tel état est donnée par S. Kierkegaard dans son livre "Plaisir et Devoir"). Puis il laisse aussi accidentellement, sans s'en apercevoir, toutes les institutions sociales morales. Et si la mesure de l'ennui a dépassé toutes les limites possibles, alors l'hédoniste ne s'arrêtera pas avant même de tuer - tout simplement pour se divertir d'une manière ou d'une autre. Soit dit en passant, l'empereur romain Néron était aussi une telle personne. En même temps, ce qui précède ne signifie pas que le plaisir lui-même ou son désir est criminel. Le plaisir lui-même ne peut être moralement coloré d'aucune façon. L'hédonisme est un crime, mais seulement lorsque le plaisir est précieux en soi pour une personne et peu lui importe de quelle source il le puise.

Formes de contrainte morale sur les désirs
- La règle d'or de la morale. Le plaisir est le résultat, et les désirs humains sont la force motrice. Par conséquent, idéalement, toutes les aspirations d'une personne devraient être conformes à la règle d'or de la moralité, qui sonne (dans sa forme la plus générale) comme suit : "Faites avec les gens ce que vous voulez qu'ils fassent avec vous."
- Création. Il a à la fois la passion, la rapidité des impulsions et la liberté. Quand une personne crée, elle gravit l'Everest du plaisir, et c'est le plaisir du plus haut niveau. C'est un mélange de plaisirs spirituels et sensuels. Il y a à la fois repos et travail. Et en même temps, cela nécessite la plus grande concentration et le plus grand dévouement du créateur.
Plaisir et sens de la vie
Armé de ce qui précède, il n'est pas difficile de comprendre que la devise "le sens de la vie est l'hédonisme" ne peut exister que si le plaisir est spiritualisé et soumis à certaines restrictions morales. Les plaisirs eux-mêmes ne peuvent pas être pris comme base de la vie ou du bonheur humain, car ils apportent toujours l'ennui avec eux, et cela ne peut être évité.
Une autre chose est que lorsqu'une personne trouve du plaisir dans le travail ou l'abnégation, alors elle et la société sont gagnantes. De plus, toute activité, même la plus insignifiante, qui ne nuit pas aux autres et conduit à l'harmonisation du monde intérieur, peut devenir une source de sens pour une personne. A de rares exceptions près, les sages le croyaient aussi (par exemple, A. Schopenhauer et Epicure). Pour eux, l'hédonisme en philosophie n'est d'abord pas l'intensité des plaisirs, mais l'absence de souffrance.
Il y avait, bien sûr, ceux qui insistaient sur la jouissance sous toutes ses formes (par exemple, les penseurs de la Renaissance). Mais maintenant, et ainsi la plupart des gens sont littéralement devenus fous sur la base du culte du plaisir. L'homme moderne aspire désespérément au plaisir, à l'harmonie de la vie intérieure et extérieure, et achète donc et achète différentes choses, en espérant qu'elles remplaceront son bonheur. Et dans une société de consommation totale de tout et de tout, la définition selon laquelle l'hédonisme en philosophie est principalement l'absence de souffrance, et non un flux boueux constant de plaisirs sensuels douteux, sera utile.
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, les étudiants diplômés, les jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous en seront très reconnaissants.
Posté sur http://allbest.ru
Théorie de l'hédonismevéthiquee
Hédonisme (grec hedone - plaisir) - un type d'enseignements éthiques et de vues morales, dans lequel toutes les définitions morales sont dérivées du plaisir et de la souffrance. Sous une forme systématique, en tant que type d'enseignement éthique, l'hédonisme s'est d'abord développé dans les enseignements du philosophe grec socratique Aristippe de Cyrène (435-355 av. J.-C.), qui enseignait que tout ce qui procure du plaisir est bon.
Considérez quelques valeurs éthiques.
Plaisir. Parmi les valeurs positives, le plaisir et le bénéfice sont considérés comme les plus évidents. Ces valeurs correspondent directement aux intérêts et aux besoins d'une personne dans sa vie. Une personne qui, par nature, aspire au plaisir ou au bénéfice semble se manifester d'une manière tout à fait terrestre.
Plaisir (ou jouissance)- c'est un sentiment et une expérience qui accompagnent la satisfaction des besoins ou des intérêts d'une personne.
Le rôle des plaisirs et des peines est déterminé d'un point de vue biologique, par le fait qu'ils remplissent une fonction d'adaptation : l'activité humaine dépend du plaisir, qui répond aux besoins du corps ; le manque de plaisir, la souffrance entravent les actions d'une personne, sont dangereux pour elle.
En ce sens, le plaisir, bien sûr, joue un rôle positif, il est très précieux. L'état de satisfaction est idéal pour le corps et une personne doit tout faire pour atteindre un tel état.
En éthique, ce concept est appelé hédonisme (du grec. fini - "plaisir"). Cette doctrine est basée sur l'idée que la recherche du plaisir et la négation de la souffrance est le sens principal des actions humaines, la base du bonheur humain.
Dans le langage de l'éthique normative, l'idée principale de cet état d'esprit s'exprime ainsi : "Le plaisir est le but de la vie humaine, le bien est tout ce qui donne du plaisir et y conduit." Freud a apporté une grande contribution à l'étude du rôle du plaisir dans la vie humaine. Le scientifique a conclu que le "principe de plaisir" est le principal régulateur naturel des processus mentaux, l'activité mentale. Le psychisme, selon Freud, est tel que, quelles que soient les attitudes d'une personne, les sentiments de plaisir et de déplaisir sont décisifs. Les plus frappants, ainsi que relativement accessibles, peuvent être considérés comme les plaisirs corporels, sexuels et les plaisirs associés à la satisfaction des besoins de chaleur, de nourriture et de repos. Le principe de plaisir s'oppose aux normes sociales de décence et fonde l'indépendance personnelle.
C'est dans le plaisir qu'une personne est capable de se sentir, de se libérer des circonstances extérieures, des obligations, des attachements habituels. Ainsi, les plaisirs sont pour une personne une manifestation de la volonté individuelle. Derrière le plaisir, il y a toujours le désir, qui doit être réprimé par les institutions sociales. Le désir de plaisir s'avère être réalisé en s'écartant des relations responsables avec les autres.
Un comportement ordinaire basé sur la prudence et l'acquisition de bénéfices est à l'opposé d'une orientation vers le plaisir. Les hédonistes distinguaient les aspects psychologiques et moraux, la base psychologique et le contenu éthique. D'un point de vue moralo-philosophique, l'hédonisme est l'éthique du plaisir.
Principeséthique des épicuriens
Le principe fondamental de l'éthique épicuriens le plaisir est le principe de l'hédonisme. En même temps, les plaisirs prônés par les épicuriens se distinguent par un caractère extrêmement noble, calme, équilibré et souvent contemplatif. Le désir de plaisir est le principe originel de choix ou d'évitement.
Selon Epicure, si les sens d'une personne sont enlevés, alors il ne reste rien. Contrairement à ceux qui prônaient le principe de « profiter de la minute », mais « quoi qu'il arrive, ce sera ! ”, Epicure veut une béatitude permanente, égale et sans fin. Le plaisir du sage "éclabousse dans son âme comme une mer calme sur des rivages fermes" de fiabilité. La limite du plaisir et de la félicité est de se débarrasser de la souffrance ! Selon Epicure, on ne peut vivre agréablement sans vivre raisonnablement, moralement et justement, et, inversement, on ne peut vivre raisonnablement, moralement et justement sans vivre agréablement. Cependant, il serait erroné de réduire toute la capacité sémantique de contenu de l'épicurisme à des motifs hédonistes.
Les épicuriens ont abordé plus subtilement et plus profondément le problème de la jouissance de la vie sous l'aspect du rapport de l'homme au monde de la culture. La jouissance de la vie, à leur avis, s'obtient par des exercices moraux, par le développement d'une attitude nouvelle et mûre face aux problèmes de la vie. Ce sont les épicuriens qui considéraient comme point de départ du bonheur, premièrement, l'absence de souffrance, deuxièmement, la présence d'une conscience claire, non accablée par des actes immoraux, et, troisièmement, une bonne santé.
Il n'est pas difficile de voir que ces trois conditions nécessaires pour qu'une personne éprouve la joie de vivre ne cadrent pas du tout avec la mythologie selon laquelle les épicuriens appelaient à l'abstinence de nourriture, de boisson, d'amour et d'autres conforts et plaisirs de la vie. Au contraire, le sens profond et subtil de l'approche épicurienne de la culture réside dans le fait que dans les textes culturels, dans divers types de créativité culturelle, ils ont vu une opportunité de renforcer le potentiel moral de l'individu, d'améliorer la sphère de sa besoins et, enfin, la possibilité de renforcer la santé.
La satisfaction de la vie et la jouissance de celle-ci étaient donc inextricablement liées aux processus de maîtrise des valeurs spirituelles et morales du passé et du présent et à la nécessité d'entrer dans l'espace culturel de la modernité.
Matérialistes dans leurs conceptions idéologiques, les épicuriens, tout comme les sceptiques, appréciaient hautement la joie de la communication entre l'homme et la nature, mais, contrairement à Pyrrho et Sextus Empiricus, eux, en particulier Titus Lucretius Carus, ont démontré dans leurs textes la possibilité d'harmoniser le quotidien relations humaines et avec la nature et avec la culture. Dans leur essence la plus profonde, l'épicurisme et le rabelaisisme, c'est-à-dire l'attitude "excessive" à l'égard de la vie proclamée dans le roman de F. Rabelais "Gargantua et Pantagruel", ne sont pas identiques.
L'épicurisme, en substance, affirme un sens de la proportion dans la relation d'une personne avec ce que la nature lui donne et ce que la culture peut lui donner, affirme qu'une attitude vraiment mature envers la vie aide une personne à éviter les extrêmes dans l'évaluation à la fois du principe élémentaire associé à la vie de la nature et la pression organisée sur la conscience individuelle de la culture officielle.
Pour les épicuriens, bien sûr, l'aspect moral et créatif du rapport quotidien d'une personne à la culture comme une seconde nature, comme une manière de s'adapter à la réalité, comme un univers symbolique dans lequel une personne pourrait exprimer son sentiment de bonheur à vivre sur cette terre et être aimé, était optimal.
C'est pourquoi, depuis l'époque où vivaient Epicure, Horace, Titus Lucretius Carus, qui ont créé le livre immortel "De la nature des choses", les motifs épicuriens ont survécu jusqu'à nos jours, étant en phase avec les générations suivantes, et se reflètent dans le travail de nombreuses personnalités culturelles exceptionnelles, y compris le XXe siècle, par exemple, Fellini, Antonioni et d'autres.
Désignant la vie elle-même comme le sens de la vie, les épicuriens enseignaient que l'idéal de l'existence humaine est l'ataraxie, ou évitement de la souffrance, une vie calme et mesurée, constituée de plaisirs spirituels et physiques donnés avec modération.
épicuriens
La vie humaine est limitée par la réalité réelle, les sensations réelles. Par conséquent, l'éthique doit inclure la science du bonheur dans cette vie réelle. Le but de notre vie est le plaisir ; le critère de notre activité est le sentiment de plaisir et de douleur. Que le plaisir soit le but le plus élevé de notre vie est aussi immédiatement évident que le feu brûle ou que la neige est blanche.
Dans l'enseignement épicurien, l'éthique grecque est la dernière fois que ce genre de sermon apparaît. Mais on ne peut pas dire que l'enseignement d'Épicure ait été en tout semblable à l'hédoniste. L'enseignement d'Aristippe est en quelque sorte plus gai, plus frais, plus jeune qu'Épicure.
Ces derniers enseignaient le plaisir de la même manière ; mais il y a en lui un trait sénile de fatigue : c'est un homme qui a perdu la foi dans le plaisir, qui aime avant tout la paix imperturbable. Il veut profiter de la vie en développant en lui-même un régime alimentaire systématique, se subordonnant à un régime strict. Il n'attrape pas les plaisirs éphémères individuels, comme Aristippe, qui voulait boire jusqu'au fond une pleine tasse de plaisirs, ne s'embarrassant pas de soucis pour le passé et l'avenir, chérissant le présent. Epicure enseigne à ne pas courir après le plaisir instantané, mais à rechercher le plaisir permanent États contentement.
Dès lors, il considère certains plaisirs comme directement nuisibles, leur apprend à les éviter. Enfin, lui, avec Platon, reconnaît que tout plaisir consiste dans l'élimination de la douleur ; par conséquent, il considère que l'état de bonheur le plus élevé est celui dans lequel toute souffrance est supprimée - bfbsboyb, qui est très similaire à l'apathie parfaite, à l'impassibilité des cyniques et des stoïques.
Tout plaisir n'a de prix pour le bonheur de vivre que dans la mesure où il contribue à l'apaisement de la souffrance. Le plaisir n'est qu'un moyen de se débarrasser d'un besoin douloureux, et les plaisirs sensuels, selon Épicure, ne font que perturber la tranquillité de l'esprit et sont donc dangereux pour lui. Épicure prêche le plaisir stable (chbfbufzmbfychz), par opposition au plaisir mobile (zdpnz zen chinzuey) d'Aristippe.
Les conditions d'un tel plaisir sont avant tout dans notre esprit ; par conséquent, Epicure place les plaisirs spirituels infiniment plus haut que les plaisirs corporels - une autre différence avec Aristippe. Et, bien qu'en fin de compte tout plaisir et toute douleur dépendent des mouvements du corps, seuls réel plaisirs et peines, par âme - à la fois futurs et passés.
L'esprit n'est pas limité au domaine du présent, et donc nous pouvons avoir du réconfort dans notre esprit face à la souffrance réelle. Et Epicure exalte le pouvoir de l'esprit sur le corps exactement de la même manière que les stoïciens et les cyniques. Il pensait qu'avec l'aide de la philosophie, une personne pouvait réellement surmonter les peines et les souffrances corporelles. A ce sujet, les épicuriens ont écrit de magnifiques récitations : "le sage, tant sur le bûcher que sur la croix, se sentira heureux et dira : comme cela m'est doux, comme tout cela ne me regarde pas".
Une condition indispensable pour un tel état d'esprit est la philosophie et la prudence. La vertu est nécessaire au bonheur, mais elle n'a pas de valeur en soi, mais seulement selon le bonheur qu'elle procure. La rationalité libère une personne de la superstition et des peurs vides ; uschtspuhnz - modération, maîtrise de soi - aide à combattre la souffrance ; le courage nous libère de la peur de la douleur, du danger et même de la mort ; la justice détruit la crainte du châtiment et est nécessaire pour assurer le calme imperturbable de la vie, dans lequel est le plus haut bonheur de l'homme. "Il est impossible de vivre agréablement sans vivre raisonnablement, modérément et justement." Mais en même temps, la justice et la vertu, comme je l'ai dit, ne jouent pour Epicure que le rôle d'un régime, qui n'a une signification que relative pour la santé humaine : rspurfxsh fsh chblsh, dit Epicure, chby fpizh chenyuzh bhfp hbhmbzhphuyn, pfbn mzdemeybn zdpnzn rpyz.
L'idéal épicurien du sage se rapproche de l'idéal stoïcien. Bien qu'Épicure ne prescrive pas au sage le calme et le renoncement parfaits aux plaisirs sensuels, il exige de lui une maîtrise de soi aussi complète, une indépendance aussi complète de tout ce qui est extérieur, que les stoïciens. Le sage, comme un dieu, marche parmi les gens ; son bonheur est si complet, si inaliénable que même étant au pain et à l'eau, il n'enviera pas Zeus lui-même.
L'éthique spéciale des épicuriens, conformément à ces dispositions, est de la même nature casuistique que l'éthique des stoïciens : c'est un ensemble d'arguments détaillés sur les plaisirs individuels, les vertus, les passions et les inclinations d'une personne, un système développé de règles du quotidien. La discrétion est le contenu principal de ses recettes; à cela s'ajoute une indépendance vis-à-vis du bonheur extérieur, un état moyen (mesure) et un éventuel éloignement de toute vie sociale - une originalité ; dans celui-ci, Epicure a rencontré Héraclite, bien que, bien sûr, les raisons qui ont poussé les deux philosophes soient différentes. Vivez tranquillement, conseillait Epicure, cachez-vous des autres ; et lui-même vécut parmi ses condisciples, comme il enseignait aux autres à vivre. L'amitié était la vertu la plus sympathique des épicuriens. Sur sa base, une bienveillance générale envers tous les peuples s'est développée. Sur la base des principes de la véritable amitié, Epicure a également rejeté le communisme de Platon : entre amis, et donc tout est en commun ; la commune, en tant qu'institution obligatoire, est un signe de méfiance. Et là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié. Epicure a reconnu et enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Apparemment, Epicure lui-même était une personnalité exceptionnelle ; c'est avec elle qu'il se lie d'amitié et sanctionne son enseignement : tandis que l'éclectisme commence à prévaloir au IIe siècle, et que l'école commence à aplanir ses traits originels, l'enseignement épicurien reste inchangé. Les attaques contre les épicuriens furent nombreuses, mais les opposants eux-mêmes reconnurent le caractère moral de leur école. Cicéron dit : "... et ipse (Epicurus) bonus vir fuit et multi Epicurei fuerunt et hodie sunt et in amicitiis fideles et in omni vita constantes et graves" (Cicéron, Fines, 11, 25, 81). Les épicuriens eurent un succès durable à Rome.
Malgré leur différence avec les stoïciens, les épicuriens étaient d'accord avec eux à bien des égards. Ils avaient une tendance pratique commune à propos de la logique : tous deux ont mis en avant la question du critère et réfuté le scepticisme au nom d'un postulat pratique : le comportement fondé sur la connaissance vraie. éthique hédonisme épicurien philosophe
En physique, tous deux considéraient l'âme comme matérielle ; et même en morale ils considéraient également la libération de soi de tout ce qui est extérieur et l'éloignement des tracas mondains comme une condition du bonheur. Tout cela montre que les enseignements stoïcien et épicurien étaient des branches d'un même tronc, qui ne divergeaient que dans des directions différentes.
Hébergé sur Allbest.ru
Documents similaires
Le sujet de l'éthique et de ses tâches, la relation avec la religion et la philosophie. Arguments prouvant l'autonomie de l'éthique. Éthique la vie de famille. Famille et mariage. Essence et sens du mariage. Principe éthique opposé au principe de l'hédonisme, et similaire à celui-ci.
test, ajouté le 16/01/2011
Le concept de miséricorde, le commandement de l'amour miséricordieux, son rapport au devoir et les exigences du Décalogue. Pensée éthique et philosophique de l'Europe des temps modernes. Caractéristiques des relations personnelles, importance des personnes les unes pour les autres. Le concept d'hédonisme, le principe de pragmatisme.
résumé, ajouté le 12/11/2009
caractéristiques générales doctrine éthique d'Épicure. Comprendre l'éthique comme une doctrine des vertus, d'une personnalité parfaite. Titus Lucretius Carus et son interprétation de l'éthique d'Épicure, les enseignements éthiques de Philodème. La vie d'un sage, d'un philosophe comme idéal moral chez Épicure.
travaux de contrôle, ajouté le 15/05/2013
Le concept d'éthique comme philosophie sur la morale, sa construction sur la base d'idées générales sur l'essence du monde et la place de l'homme en lui. La morale et l'éthique en tant que véritables phénomènes spirituels et sociaux étudiés par l'éthique. Développement historique de la doctrine éthique.
présentation, ajouté le 07/07/2012
L'éthique de l'antiquité, son appel à l'homme. Caractéristiques de la position éthique des anciens sages. principales écoles philosophiques. Socrate et les écoles socratiques. Cyrénaïque, éthique de l'hédonisme. développement de la philosophie stoïcienne. L'éthique des épicuriens : les peurs et leur dépassement.
présentation, ajouté le 11/05/2013
Les principaux problèmes d'éthique : les critères du bien et du mal, le sens de la vie et le but d'une personne, la justice et le dû. Caractéristiques, structure et principales catégories de l'éthique en tant que théorie de la morale. Contexte socioculturel et contenu des enseignements en éthique de la Chine ancienne.
essai, ajouté le 12/07/2011
Histoire des doctrines éthiques. enseignements éthiques ancien monde. Enseignements éthiques du Moyen Âge. Caractéristiques et principaux problèmes de l'éthique des temps modernes. Tendances éthiques au XIXe siècle. Quelques enseignements dans l'éthique du XXe siècle. Développement historique de la morale.
cours magistraux, ajouté le 17/11/2008
Éthique communication d'entreprise. Analyse de l'état des relations sociales dans les entreprises afin d'identifier les principales (principales exigences) en matière d'éthique de gestion. Direction et responsabilité. La différence entre l'éthique philosophique et l'éthique religieuse.
résumé, ajouté le 12/09/2010
La nature du bien et du mal. La position de l'éthique par rapport à l'un des problèmes éternels de la morale - le mal moral. Mutualité et opposition absolue du bien et du mal. Le problème de la constructivité du rôle du mal dans l'histoire. La nature du mal dans l'éthique socratique.
résumé, ajouté le 28/11/2010
Les principales étapes et directions du développement de l'éthique. Enseignements éthiques de l'Orient ancien. Doctrine chrétienne médiévale de la morale. Contenu social et éthique de l'idéologie humaniste de la Renaissance. Les concepts de samsara, karma, dharma et moksha.
Enseignements éthiques empiriques : hédonisme, eudémonisme, utilitarisme
Texte 3. La morale de l'empirisme a pour tâche de faire dériver de l'expérience le principe suprême de la morale, c'est-à-dire définition du bien le plus élevé ou du but normal de l'activité pratique. Dans l'infinie variété des biens subjectifs et relatifs, n'y a-t-il pas quelque élément commun et constant qui leur soit également inhérent à tous ? Tout d'abord, un tel élément est le plaisir ou la jouissance. En effet, la présence de toute bonne chose nous procure nécessairement un plaisir physique ou spirituel ; ainsi, le plaisir au sens le plus large est un signe général et constant de tout bien, et donc un signe nécessaire du bien en général, ou du bien en tant que tel.
Une doctrine éthique qui se borne à ce seul signe ou définition du plus grand bien, comme plaisir, et, par conséquent, dans le plaisir, en supposant le but normal de la vie humaine, s'appelle hédonisme(à partir de mot grec- jouissance ou jouissance .
Puisque selon les conditions éthiques de la nature humaine, ainsi que selon les conditions logiques de l'être fini ou limité en général, le plaisir ou la jouissance ne doit pas être un état constant et continu, mais doit nécessairement être entrecoupé d'états opposés de déplaisir et de souffrance, le principe de l'hédonisme ne peut avoir de signification pratique que si , s'il se fixe comme but ultime non pas l'accomplissement d'un état de plaisir continu, ce qui est impossible, mais seulement l'accomplissement d'une telle existence dans laquelle les états agréables prévalent et dominent constamment sur les états désagréables. États. Un tel état s'appelle le bonheur, une vie heureuse ou bienheureuse, et ainsi le principe de l'hédonisme, plus précisément exprimé, devient le principe eudémonisme(du mot grec - félicité, bonheur) .
Le but normal de l'activité pratique est d'atteindre la béatitude ou une vie heureuse. Sous une forme aussi générale, ce principe d'eudémonisme est sans doute vrai, et si la dispute sur les mots est éliminée, alors ᴇᴦο est également reconnu par tous les enseignements éthiques les plus divers. Le bonheur est la prédominance des états agréables sur les états désagréables.
Nous trouvons dans l'expérience que quatre sortes de plaisirs ou plaisirs sont caractéristiques de l'homme : premièrement, les jouissances matérielles de l'homme en tant qu'organisme animal ; deuxièmement, les plaisirs esthétiques ; troisièmement, les plaisirs mentaux ; quatrièmement, les plaisirs de la volonté ou plaisirs proprement moraux.
Notre expérience intérieure témoigne sans doute de l'existence de tels plaisirs ou plaisirs positifs, qui ne résultent ni de la satisfaction de désirs corporels ou mentaux ou esthétiques, mais sont d'un caractère purement pratique ou moral, se rapportant directement au domaine de la volonté. Notre volonté et l'activité pratique qui en découle, au sens exact du terme, ont nécessairement d'autres êtres pour objet immédiat.
En agissant sur d'autres êtres, on peut tendre à l'affirmation exclusive de soi par rapport à ces êtres et, par conséquent, à leur négation, c'est-à-dire à leur négation. à leur assujettissement à nous, à notre domination sur eux, ou même à leur destruction complète.
Enseignements éthiques empiriques : hédonisme, eudémonisme, utilitarisme - concept et types. Classement et caractéristiques de la catégorie « Enseignements éthiques empiriques : hédonisme, eudémonisme, utilitarisme » 2015, 2017-2018.
plaisir") - doctrine éthique qui considère le plaisir comme le plus grand bien, et le désir de plaisir comme le principe du comportement. Conçu par Aristippe (Cyrénaïque). Il doit être distingué de l'eudémonisme, qui reconnaît la poursuite du bonheur comme la base du comportement moral.
Grande définition
Définition incomplète ↓
HÉDONISME
grec plaisir) est une manière d'étayer la morale et d'interpréter sa nature et ses objectifs, largement utilisée dans l'histoire de la pensée éthique. G. réduit tout le contenu des diverses exigences morales à un objectif commun - obtenir du plaisir et éviter la souffrance. Cet objectif est considéré comme le principe moteur d'une personne, ancré en lui par la nature (Naturalisme) et déterminant finalement toutes ses actions. En tant que principe de moralité, qui prescrit aux gens le désir des joies terrestres, G (comme l'eudémonisme) est le contraire de l'ascèse. Dans l'Ancien. Grèce, l'un des premiers philosophes qui ont réalisé le principe de G. dans l'éthique ont été Démocrite et Aristippe. G. Epicure est surtout connu pour sa justification, au nom de laquelle toute une tendance de la théorie morale est associée - les idées de l'épicurisme G. ont également été prêchées par le disciple romain d'Epicure Lucrèce. Au Moyen Âge, les idéologues église chrétienne G. vivement condamné, considérant les plaisirs terrestres comme un péché (Sin).Le principe de G. en éthique renaît à l'ère de l'émergence et de l'établissement de relations bourgeoises. Ce n'est pas un hasard, puisqu'il était la meilleure réponse à la vision bourgeoise « classique » d'une personne, avant tout, en tant qu'entrepreneur privé (« la force motrice de la société est une personne privée poursuivant ses propres intérêts ; le but de la société et, par conséquent, la morale doivent être le bien de cet individu, et son bien-être matériel est, en dernière analyse, le contenu du bien universel.) Hobbes, Locke, Gassendi, Spinoza et les matérialistes français de le XVIIIe siècle, dans leur lutte contre la compréhension religieuse de la morale, recourut souvent à une interprétation hédoniste de la morale. Plus tard, le principe de G. trouva son expression la plus complète dans l'utilitarisme. Les idées de G. sont partagées par de nombreux théoriciens de la morale moderne. éthique bourgeoise - J. Santayana, M. Schlick, D. Drew, etc. Dans les temps anciens et modernes, G. a joué un rôle généralement progressiste et éthique, puisqu'il s'opposait à la morale religieuse et représentait sa propre tentative d'interprétation de la morale positions matérialistes Cependant, il ne peut être considéré principe scientifique théorie éthique De plus, cela ne correspond pas au niveau moderne des titres sur une personne. Le marxisme considère l'homme comme un être social. Avec ce t sp. la réduction des divers besoins humains à la jouissance est une simplification extrême et : découle en définitive d'une compréhension biologique ou purement psychologique de l'homme en tant qu'être naturel Le principe hédoniste, en outre, est de nature individualiste et gravite souvent vers le relativisme éthique. Les plaisirs eux-mêmes, auxquels les gens aspirent, sont de nature historique concrète, leur contenu n'est pas le même dans les différentes époques hystériques et parmi les différents groupes sociaux. C'est donc seulement dans la pratique sociale qu'il faut chercher l'origine des siècles d'aspirations et de buts que les hommes se sont fixés. Dans la société bourgeoise moderne, un complexe d'idées morales d'anarcho-G. est en train de se former, où les inclinations «naturelles» d'une personne à des plaisirs illimités sont mystifiées et déifiées, la discipline du travail, les devoirs sociaux, les normes culturelles et morales sont rejetées comme à la base du conservatisme (nihilisme), on revendique la recherche de nouveaux liens primitifs incontrôlés entre les peuples, la légalisation de l'immoralité. Anarcho-G. sert, d'une part, de moyen extrême de diffusion/moralité de masse du consumérisme, et d'autre part, de moyen de détourner les couches critiques de la société bourgeoise de la morale vraiment révolutionnaire
Grande définition
Définition incomplète ↓